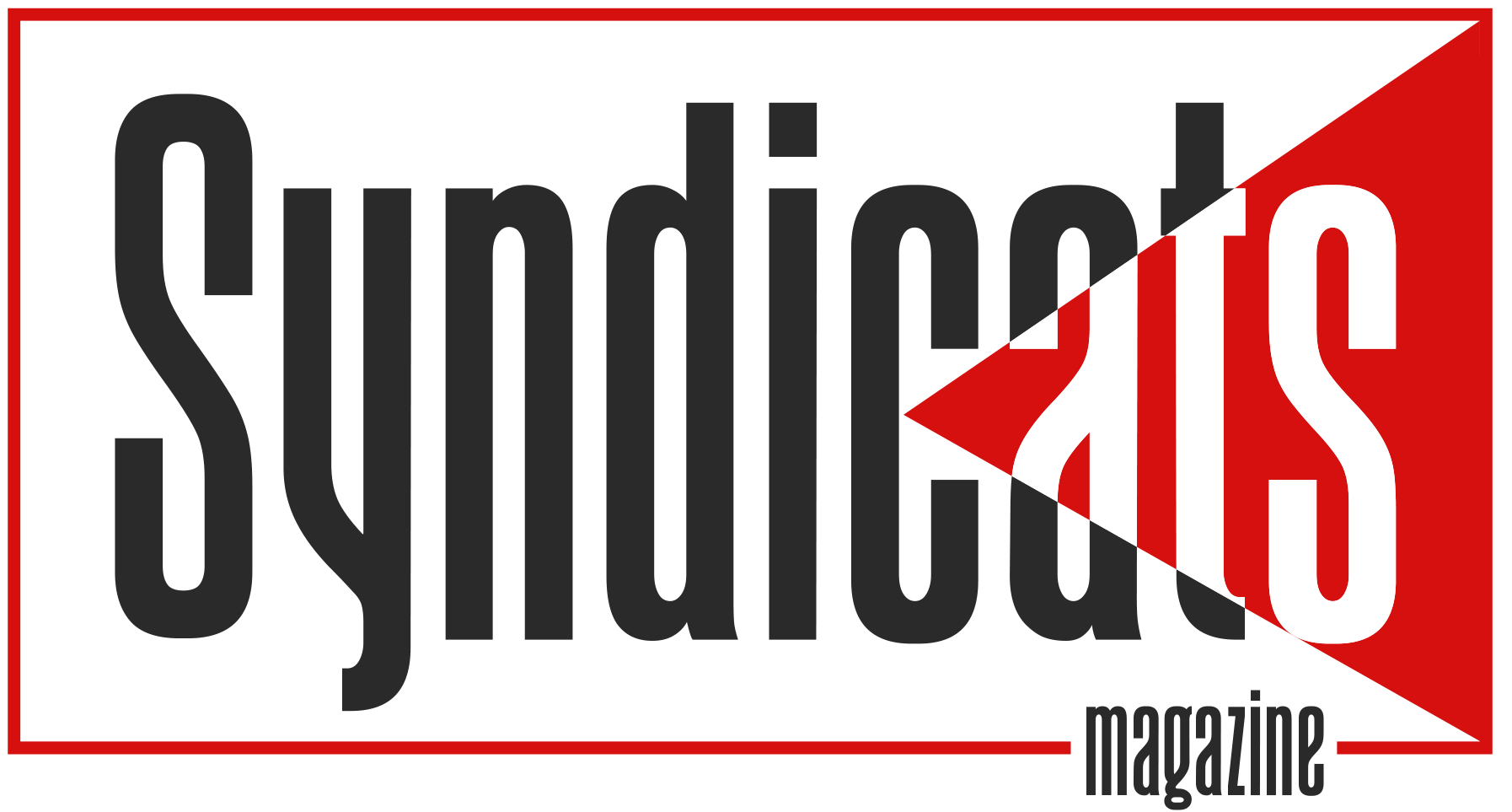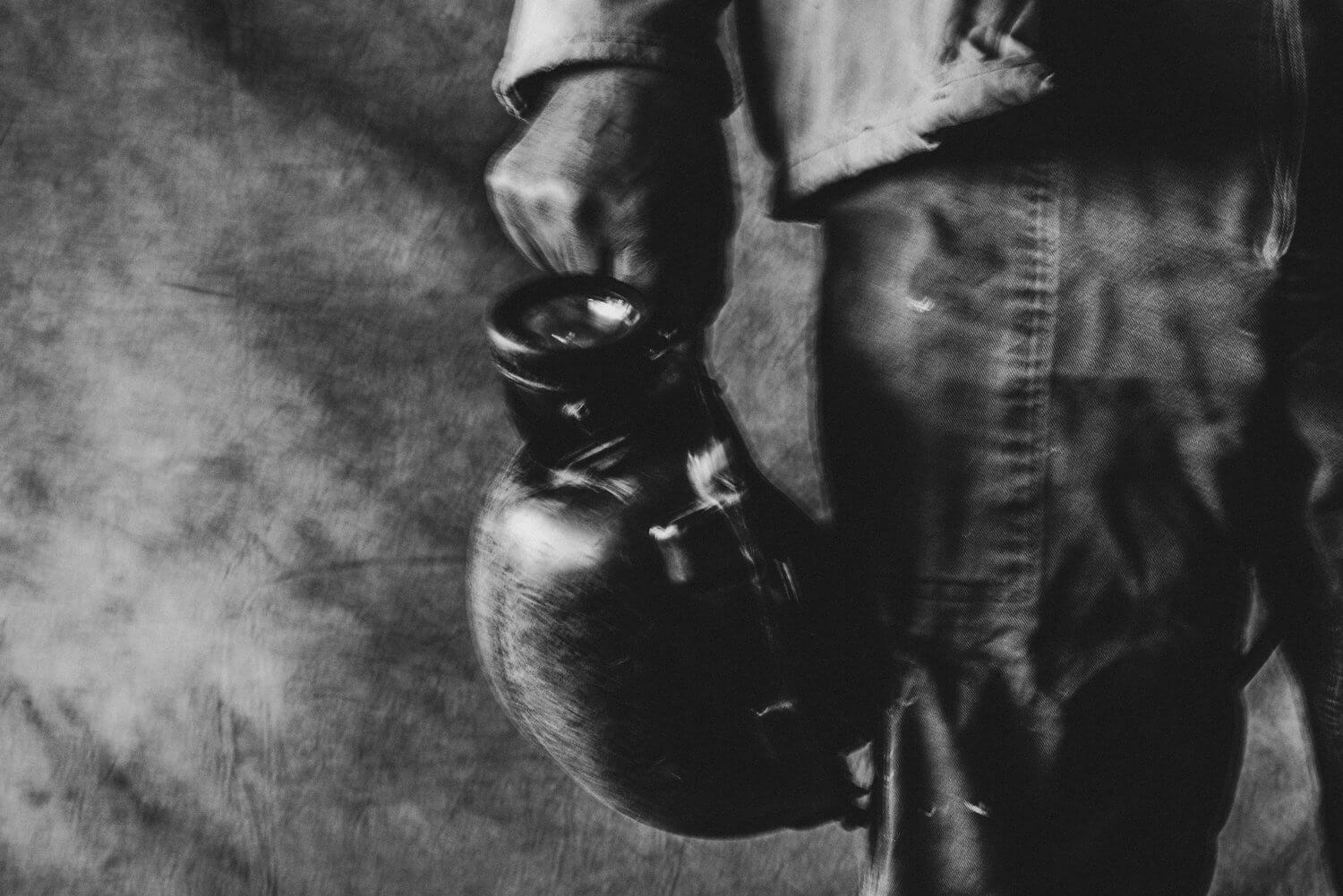L’histoire de la Belgique est faite des multiples histoires. Parmi elles, celles de l’immigration. Celles de centaines de milliers d’hommes et de femmes qui ont courageusement quitté leurs pays d’origine pour chercher ailleurs une vie meilleure. Ces parcours marqués de sacrifices ont contribué à la prospérité économique du pays, ont façonné les usines, les quartiers… Ont fait de la Belgique ce qu’elle est aujourd’hui. Dans cet article, nous revenons sur un pan important de cette histoire : l’immigration turque et marocaine, dont on a récemment commémoré les 60 ans. Et les défis syndicaux qui les ont accompagnés.
Les débuts de l’immigration d’après-guerre
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la Belgique doit se reconstruire. Mais elle manque de main-d’œuvre pour extraire le charbon de ses mines, les Belges ne souhaitent pas retourner dans le fond à cause des conditions de travail. Le pays se tourne donc vers l’Italie, qui se trouve alors dans une situation économique et politique instable. En 1946, les deux pays signent l’« Accord charbon ». « C’est la première convention d’immigration organisée », nous explique Renée Dresse, historienne au CARHOP (Centre d’Animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire) et invitée pour une conférence sur les 60 ans de l’immigration turque et marocaine organisée notamment par le CEPAG et la FGTB Verviers. 50 000 travailleurs italiens migrent alors vers la Belgique pour travailler dans les mines.
Fin 1947, la situation économique se dégrade. L’attitude des organisations syndicales vis-à-vis de la vague d’immigration est paradoxale. « D’un côté, on veut contrôler l’immigration organisée par peur qu’elle ne crée de la concurrence à d’autres secteurs. Et de l’autre, on défend les droits des travailleurs immigrés et on veut les organiser ». On se heurte aussi au manque de culture syndicale des travailleurs italiens, héritage de la politique de Mussolini.
Pour les syndicats, il est primordial de se pencher sur les défis liés à l’immigration. En 1948, la Commission tripartite de la main d’œuvre étrangère (CTMOE) est créée. Elle réunit syndicats, patrons et gouvernement. Au sein de la FGTB, on crée la Commission des travailleurs immigrés qui a une mission d’information et d’étude. L’important du travail se mène sur le terrain : dans les usines, les mines, par les délégués directement.
Des Italiens aux Espagnols, en passant par les Hongrois… jusqu’aux Marocains et aux Turcs
Très vite, les relations entre la Belgique et l’Italie se dégradent, principalement en raison des failles en matière de sécurité dans les mines. « L’Italie décide alors d’arrêter l’immigration officielle. » explique Renée Dresse. En 1956, la Belgique signe des accords avec la Grèce et l’Espagne.
« En 1962, le gouvernement mène deux études sur la situation démographique wallonne. » Les résultats : la population vieillit. De plus, les mines nécessitent encore des ouvriers. La Belgique lance alors les négociations avec des pays supplémentaires et facilite le regroupement familial. En février 1964, elle signe avec le Maroc une convention « d’occupation de travailleurs ». En juillet de la même année c’est avec la Turquie qu’elle conclut un accord. Les ouvriers turcs et marocains travailleront principalement dans la métallurgie et dans les mines.
Défis et réponses
Chaque vague d’immigration est confrontée aux mêmes problèmes de logement, aux questions alimentaires, aux conditions de travail difficiles… Mais pour les Marocains et les Turcs, il y a de nouvelles difficultés qui se posent : la culture et la religion. À titre d’exemple, dans les cantines, on mange du porc et boit de l’alcool. Les travailleurs arrivés ne comprennent pas non plus le système de salaires, les retenues faites pour la sécurité sociale… Pour faciliter l’adaptation des travailleurs turcs, certains charbonnages engagent des assistants sociaux turcs, organisent des cours de langue, des réunions hebdomadaires pour faire le point.
Autre défi : celui des travailleurs « touristes », arrivés en Belgique sans contrat de travail. Leur premier permis n’est valable que 6 mois et ne leur donne aucune garantie en cas de chômage ou de licenciement.
La fin de l’immigration officielle
En 1973, le choc pétrolier, la crise et le chômage qui en découlent créent une situation compliquée pour les travailleurs touristes qui, ne pouvant pas obtenir de permis de travail, sont contraints de travailler au noir et deviennent une proie facile pour des employeurs sans scrupules.
« Pour dénoncer cette situation, ils décident de mener une grève de la faim dans l’Eglise Saint-Jean et Nicolas à Schaerbeek. Les organisations syndicales la soutiennent. » explique l’historienne. « Parallèlement, elles se battent pour que les travailleurs migrants aient les mêmes droits que les autres travailleurs. Grâce à leur lutte, ils pourront par exemple se présenter comme candidats aux élections sociales. », ajoute Renée Dresse.
En août 1974, le gouvernement décide de régulariser 8 500 travailleurs sans-papiers et de mettre un terme aux grandes opérations de recrutement de main-d’œuvre étrangère. C’est la fin de l’immigration officielle et un grand chapitre de l’histoire de la Belgique qui se referme.

TÉMOIGNAGE
« Je suis citoyen belge, mais je n’oublie pas mes origines. »
Atila Selvi est arrivé en Belgique en avril 1975. Il a d’abord travaillé dans l’usine de Ford, à Genk. Mais très vite, la crise économique des années 80 a frappé. « Une semaine on avait du travail, la semaine suivante, non. » Il a donc décidé de rejoindre son père à la mine. Il y a travaillé pendant 12 ans. « On travaillait 8h par jour, 5 jours par semaine. Mais il y avait souvent des accidents. J’ai perdu un membre de ma famille suite à une explosion dans la mine de Maasmechelen. », explique-t-il.
Concernant son engagement syndical, il raconte avoir été approché par les délégués FGTB chez Ford. Il s’est immédiatement affilié pour être protégé. Quand la mine où il travaillait a fermé ses portes, il s’est mis en grève. « 50% de nos demandes ont été acceptées », se souvient-il avec fierté. « Ceux qui travaillaient depuis 25 ans ont reçu le double de ce qui était initialement proposé ».
Aujourd’hui, Atila et son épouse, Meliha, sont reconnaissants envers leur terre d’accueil. « Nous avons quitté le pays à cause du manque d’opportunités. » confie-t-il. « Ici nous avons trouvé les fondations pour mener une vie digne ». Et conclut : « Je suis citoyen belge, mais je n’oublie pas mes origines. »
Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui, 60 ans plus tard, les générations turques et marocaines descendantes de ces travailleurs n’oublient pas. « Mon père est arrivé dans les années 70. À l’époque, l’Europe, c’était un peu l’Eldorado, notamment en matière de soins de santé. », nous confie Mounya Mehdaoui, permanente d’origine marocaine à la Centrale Générale FGTB de Bruxelles. Elle suit actuellement le secteur du nettoyage, dans lequel il y a énormément de travailleurs et travailleuses marocains. « Ils pensent souvent qu’ils ne savent faire que ça », déplore-t-elle.
Dans son parcours, Mounya a eu la chance de ne pas avoir été confrontée à de grandes difficultés liées à son origine, mais elle est consciente que les discriminations existent, notamment dans le monde du travail : « Une femme marocaine voilée doit davantage faire ses preuves qu’une femme blanche ».
Nous avons rencontré Mounya et son collègue Abdel, lui aussi d’origine marocaine, quelques jours après l’attaque raciste des supporters du FC Bruges contre les habitants de Molenbeek. Ils sont touchés, mais pas surpris. « Vu les discours décomplexés de la droite et de l’extrême droite, ça ne m’étonne pas », regrette Mounya. Pour les permanents syndicaux, le racisme se banalise et se renforce. « On doit être vigilants et armer nos enfants ».

« Une immigration réussie »
Si actuellement la situation se complique, « pour les Marocains de l’époque, l’immigration est réussie. » explique Abdel. « Ils ont travaillé dur, acheté une maison, construit un avenir pour leurs enfants… Certains ont atteint des postes à responsabilités, d’autres sont devenus délégués syndicaux, et ils en sont très fiers ». Aujourd’hui Mounya et Abdel se sentent belges, mais tout comme Atila, ils restent attachés à leurs origines. Et c’est cela qui fait la richesse de la Belgique.

« Pour les Marocains de l’époque, l’immigration est réussie. Ils ont travaillé dur, acheté une maison, construit un avenir pour leurs enfants… »
— Abdel, Permanent CG FGTB Bruxelles
En ce qui concerne le mouvement syndical, il a été confronté à un chamboulement avec l’arrivée massive des travailleurs immigrés. Tiraillé entre les intérêts des uns et les droits des autres, il a dû s’adapter, proposer des solutions, fidèle à ses valeurs : la défense des droits des travailleurs, l’amélioration des conditions de travail sur le terrain, la régularisation des sans-papiers. Des valeurs qu’il continue à défendre aujourd’hui.
Photos : Ali Selvi et Ioanna Gimnopoulou