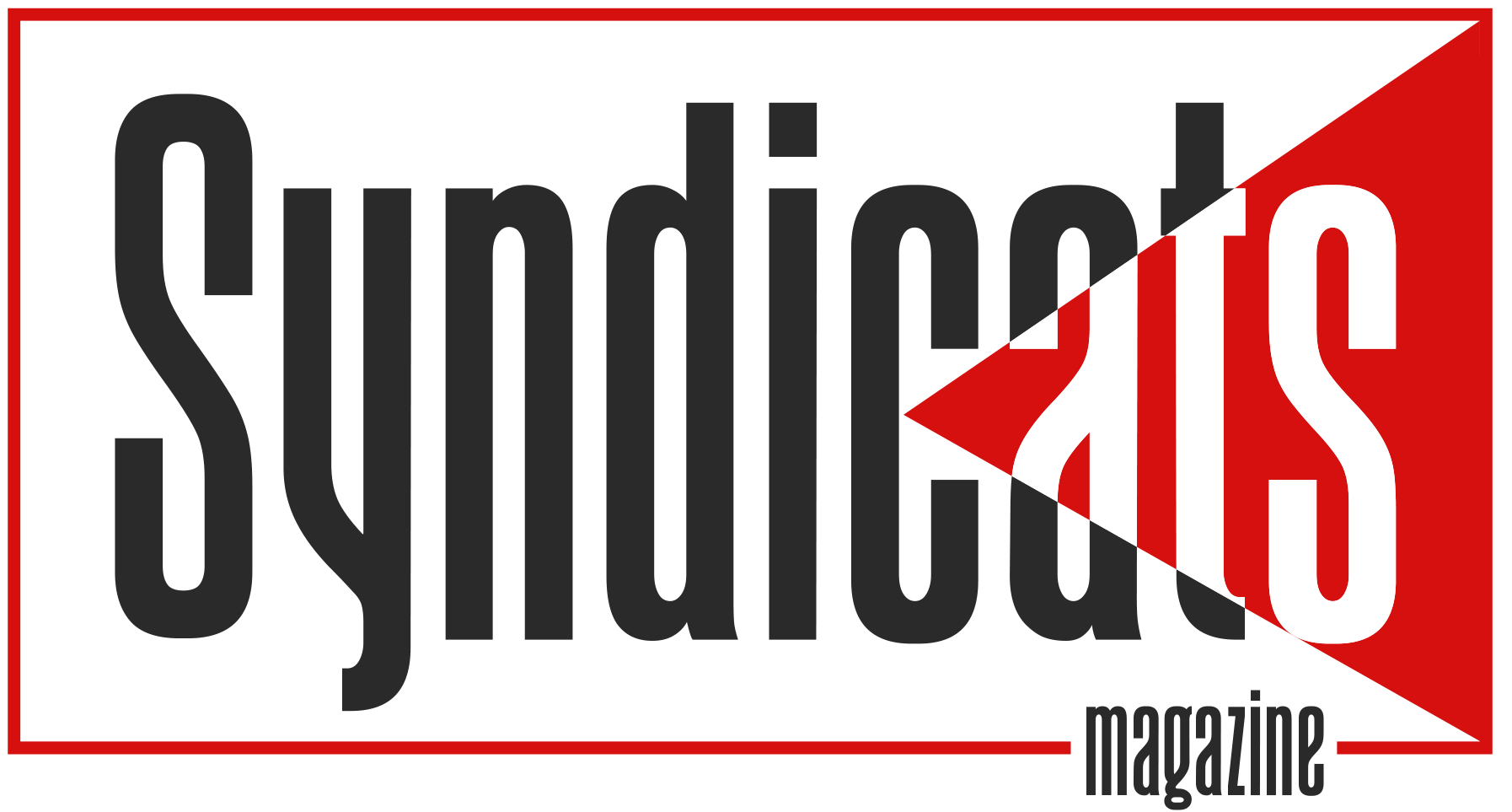Le gouvernement dévoilait son budget voici quelques semaines, et celui-ci comprenait une mesure qui touche de très près la jeunesse : l’extension du « job étudiant » de 475 à 600 heures annuelles.
En nombre d’heures, cela représente 0,4 ETP. Presque un mi-temps, donc. En plus, évidemment, des études. Une nouvelle qui a réjoui certains milieux, dont la droite et la patronat, qui peuvent ainsi compter sur des cotisations sociales réduites, et dès lors une main d’œuvre moins chère. Pourtant, étendre le nombre d’heures de travail des jeunes ne vient en aucun cas solutionner un problème pourtant crucial : la précarité étudiante. A contrario, elle vient accentuer la mise en concurrence entre travailleurs réguliers et jobistes, ainsi que les inégalités sociales entre étudiants.

Nous en parlons avec Florian Gillard, étudiant en sociologie à l’ULB, membre de l’Union syndicale étudiante (section membre des Jeunes FGTB), ainsi qu’avec Raphaël D’Elia, en charge de la communication chez les Jeunes FGTB.
Pourquoi n’est-ce pas une bonne chose d’augmenter les heures de travail des « jobistes » ?
Parce que ce n’est pas un modèle pérenne pour lutter contre la précarité étudiante. Ce n’est pas quelque chose qui améliore les conditions de vie de ces jeunes. Il ne faut pas oublier que le job d’un étudiant, c’est d’étudier. On sait que le travail, en plus des études, vient empiéter sur les heures d’études.
De plus, on entend les arguments de la droite comme « cela contribue à la formation, à l’expérience ». Ce n’est pas correct. La grande majorité des jobistes ne travaillent pas dans la branche qui correspond à leurs études. Ça n’a donc rien à voir avec une formation.
C’est une forme de dumping social ?
Le discours libéral sous-entend que quand les syndicats s’opposent aux jobs étudiants « étendus », ils souhaitent l’appauvrissement de ces étudiants. C’est inverser notre propos. En réalité, ce sont les employeurs qui bénéficient de cette mesure. Les cotisations sociales sont réduites pour les étudiants (1) ; ils deviennent donc une main d’œuvre moins chère, qui potentiellement « remplace » un travailleur régulier. Et moins de cotisations, c’est moins de participation à la sécurité sociale, et moins de moyens pour lutter contre la précarité. Mais cet aspect-là ne semble pas très concret pour la jeunesse concernée, malheureusement.
Ces jobs étudiants sont non seulement une catastrophe pour la réussite dans l’enseignement supérieur mais ils contribuent par ailleurs à maintenir un certain élitisme dans les universités et les hautes-écoles, où l’impact des inégalités sociales est fort. En effet, le statut social et la situation économique des étudiant·es ont aussi une relation avec la nature du travail dans lequel les étudiant·es s’engageront, les plus précaires sont les plus à même à accepter des jobs difficiles et contraignants. Ces étudiant·es devront également prester plus d’heures que les plus favorisé·es, ce qui signifie moins de temps pour étudier et moins de chances de réussite.
Communiqué Jeunes FGTB
On sait que c’est un sujet qui percole peu, même dans les milieux étudiants…
Oui. Dans les cercles étudiants, l’extension des heures de travail étudiant passe plus ou moins inaperçue. Et les jeunes en situation de précarité sont en recherche de solutions à court terme comme celle-là. Dans l’opinion publique en général, on est encore sur l’idée que l’étudiant est un privilégié qui travaille un peu pour payer ses sorties et ses loisirs. C’est faux. Cette époque est révolue. Les étudiants qui travaillent le font pour vivre, pour payer leurs études et leurs factures. Il faut des mesures structurelles pour lutter contre la précarité étudiante, pas des petits pansements.
Cette forme de précarité reste méconnue ?
C’est un sujet peu investigué, voire pas pris au sérieux par le monde politique. Il faut continuer à se battre pour que la précarité étudiante soit reconnue et prise en charge au niveau politique. La solution ne viendra certainement pas de l’épuisement des jeunes. Depuis 10 ans, le nombre d’étudiants qui travaillent est en constante augmentation. On en est au point où certains ne peuvent plus se nourrir correctement. Des écoles et cercles étudiants organisent des repas solidaires, à bas prix. Pendant la crise du Covid, on a vu sur le terrain énormément de preuves et témoignages de cette précarité.
Quid des aides possibles ?
Elles sont insuffisantes. Les bourses et allocations sont extrêmement faibles. S’ajoutent quelques aides qui viennent directement des établissements scolaires… Mais tout cela, en plus, n’est pas indexé, donc ça n’aide que très peu. Des étudiants se tournent vers les CPAS, et signent alors un « projet individualisé d’intégration sociale ». Ce qui est très conditionné à la réussite, et il arrive même que le choix d’études du jeune soit remis en question… Ce qui est souvent mis en avant dans ce genre de projet, c’est l’objectif d’ « employabilité ». Mais nous tenons à rappeler que les études sont d’abord un moyen d’émancipation, d’apprentissage, et pas seulement une fabrique à bons travailleurs.
« Indispensable pour vivre »
L’ULB menait en 2021 une enquête sur les ressources économiques des étudiants. Celle-ci met en avant que pour environ 30% de l’ensemble des étudiants interrogés, les ressources financières disponibles viennent principalement de leur travail rémunéré. Plus de la moitié de ces « jobistes » déclarent que cette activité rémunérée leur est « indispensable pour vivre. De plus, la moitié signale avoir déjà raté les cours pour s’y rendre. On note également que près de la moitié des étudiants et étudiantes mentionnent nouer difficilement voire très difficilement les deux bouts en fin de mois. Il semble alarmant que 13,2% d’entre eux signalent ne pas se permettre de chauffer suffisamment leur logement car ils ou elles n’en ont pas les moyens ou pour d’autres raisons. »
Source : Enquête sur les ressources économiques des étudiant.e.s, juin 2021 / Observatoire de la Vie Étudiante de l’ULB, par CAUWE Jade et PAUME Juliette / Lire tous les résultats de cette enquête : https://www.ulb.be/fr/ove/rapport-de-synthese-enquete-sur-les-ressources-economiques-des-etudiant-es
- Les jobistes cotisent à 2,71% (cotisation de solidarité) contre 13,07% pour un ou une travailleur·euse ordinaire. De son côté, le banc patronal cotise à 5,42% à la sécurité sociale pour les étudiant·es contre au moins 25% pour un travailleur à occupation principale. Parallèlement à cela, cette augmentation du nombre d’heures pour les jobistes s’accompagne d’une réduction de 7% des cotisations patronales, ce qui équivaut à un déficit pour l’Etat de plus d’1 milliard d’euros.