Pourquoi vouloir à tout prix grossir les rangs des manifestations pour Gaza ? Pourquoi ne pas vous concentrer sur les réformes socio-économiques en Belgique et sur la réalité des travailleuses et travailleurs belges ? C’est la question à laquelle les syndicalistes sont souvent confrontés. La réponse à cette question dépasse, pour autant que l’on puisse « dépasser » un génocide en cours, le sort qui est infligé aujourd’hui aux Palestiniens.
Elle trouve ses racines dans l’engagement historique des syndicats pour la paix. Parce que les travailleurs et travailleuses ont toujours été la première chair à canon des conflits armés. Les guerres bafouent les droits humains et les droits socio-économiques. Elles détruisent les moyens de production, obligent à des déplacements de population, déchirent les peuples et les familles. Les guerres appauvrissent. Elles envoient à la mort des travailleurs pour servir des intérêts qui ne sont pas les leurs. Mais les guerres font également reculer toutes les conquêtes sociales. C’est pourquoi les luttes syndicales sont intrinsèquement liées au mouvement pour la paix.
Une responsabilité
« Avec 190 millions de membres, répartis dans 169 pays, nous sommes la plus grande organisation sociale du monde. À ce titre, nous avons la responsabilité d’impulser une mobilisation pour la paix. Car chaque euro investi dans l’armement, est un euro qui ne va pas aux financement des écoles et des hôpitaux ». Ce sont les mots choisis par Luc Triangle, Secrétaire général de la CSI, pour entamer un débat sur les syndicats et la paix le 14 septembre dernier, en marge du festival Manifesta, à Ostende. Thierry Bodson, Président de la FGTB, y participait également.
Nous avons la responsabilité d’impulser une mobilisation pour la paix. Car chaque euro investi dans l’armement, est un euro qui ne va pas aux financement des écoles et des hôpitaux.
Luc Triangle, Secrétaire général de la CSI
Jeremy Corbyn, lors de ce même débat, a quant à lui rappelé combien la diplomatie, le droit international et la coopération entre syndicats à travers les frontières, étaient nos boussoles. « Toute ma vie, j’ai été syndicaliste. Toute ma vie, j’ai milité pour la paix », a-til ajouté.
À chaque génération de syndicalistes son flambeau pacifiste
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les syndicats belges se sont clairement engagés contre le militarisme. Dans les années ‘60, ils dénoncent la prolifération des armes atomiques. Dans les années ‘80, l’installation de missiles nucléaires américains à Florenne mobilise 400.000 personnes lors d’une manifestation historique : « des emplois, pas des missiles » , scandent alors FGTB et CSC, ensemble. De la même manière, les syndicats ont combattu l’apartheid en Afrique du Sud, se sont opposés ouvertement à la guerre en Irak avec une manifestation de plus de 100.000 personnes. Et plus récemment, ont défilé pour la fin des hostilités en Ukraine, chaque génération syndicale reprenant le flambeau pacifiste.



Quelques affiches du mouvement syndical pour la paix. © Bread & Roses
Le retour du discours militariste
Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le spectre d’une troisième guerre mondiale est agité. Les comparaisons avec les années ‘30 sont légion et nous assistons au retour en force du discours militariste. C’est ce qu’ont souligné, avec une similarité frappante, chacun·e des syndicalistes présents dans le panel du débat. En Allemagne, en grande Bretagne, en Belgique, le phénomène est identique. Seuls les montants injectés dans l’armement varient en fonction de la taille du pays.
Des manifestations déferlent sur les capitales pour dénoncer les plans d’austérité qui frappent les travailleurs pendant que des milliards d’euros sont investis dans la Défense. Le discours politique qui justifie ce choix est souvent le même aussi.
Propagande de guerre
Cela nous renvoie aux travaux d’Anne Morelli sur la propagande de guerre. Selon l’historienne, la rhétorique suit toujours le même schéma, qui a pour but de convaincre l’opinion publique en utilisant des valeurs morales. C’est-à-dire qu’officiellement, personne ne veut la guerre. C’est toujours la faute unilatérale de l’autre, de l’ennemi. Ennemi qui, de préférence, est dépeint comme quelqu’un qu’il est impossible de raisonner. C’est toujours pour défendre la démocratie, la civilisation ou les droits humains que nous serions bien obligés de nous préparer à la guerre. Et toute personne qui remettrait en question le bienfondé de cette guerre ou qui tenterait de nuancer le propos, serait perçue plus ou moins directement comme un traître à la cause, à la démocratie.
« Plus jamais ça »
La FGTB, à l’instar d’autres organisations syndicales, a toujours refusé de tout gober en bloc. Elle rappelle que les travailleurs et travailleuses paient trois fois la facture d’une guerre : par leurs impôts détournés vers l’armement, par les coupes dans les budgets sociaux et par leur vie ou celle de leurs enfants.
Le monde commémore cette année les 80 ans des catastrophes nucléaires d’Hiroshima et Nagasaki. Le combat pour la paix consiste aussi à répéter « plus jamais ça ». Il appartient aux organisations syndicales
de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter la guerre ou la boycotter. En valorisant le rôle de l’ONU plutôt que celui de l’OTAN. En organisant des manifestations contre la guerre, en soutenant les grèves qui entravent la livraison d’armes en Israël. Et en soutenant celles et ceux qui, au péril de leur vie, constituent la flottille pour Gaza. Parce que Gaza, à cause de l’horreur qui s’y déploie, doit provoquer le réveil d’un mouvement mondial pour la paix. Et pour l’Humanité.
Le combat pour la paix consiste aussi à répéter « plus jamais ça ».
« Ne laissez pas le rameau d’olivier tomber de ma main. »
À Gaza, non seulement le droit international est piétiné de toutes parts mais l’extermination systématique d’un groupe ethnique se déroule sous nos yeux. Un génocide est en cours et ces seuls mots devraient suffire à révolter l’humanité tout entière. La solidarité internationale avec les travailleurs est dans l’ADN de notre organisation syndicale. Autant dire qu’en Palestine, les motifs d’indignation et de dénonciation sont nombreux.
La colonisation impose aux travailleurs et travailleuses palestiniens des restrictions de libre circulation, de droit au travail, de droit à une vie décente, à la santé et à l’éducation et ce depuis des décennies. Le territoire y est littéralement confisqué. Yasser Arafat, chef de l’Autorité palestinienne, a prononcé ces mots lors de sa première intervention à la tribune des Nations Unies en 1974 : « Aujourd’hui, je suis venu porteur d’un rameau d’olivier et d’un fusil de combattant de la liberté. Ne laissez pas le rameau d’olivier tomber de ma main. Je le répète : ne le laissez pas tomber de ma main ». 51 ans plus tard, que pouvons-nous objectivement dire de l’action et de l’inaction des puissances mondiales et en particulier celle de l’Union européenne, pour que le rameau d’olivier ne tombe pas ?
La FGTB ne détournera pas le regard car Gaza est le miroir de tous les peuples qu’on opprime. Les mécanismes de prédation qui s’y déroulent, au mépris du droit international, pourraient nous concerner de très près. Car si l’on permet de bafouer le droit d’un peuple à disposer de lui-même en Palestine, à quoi sert le droit ?
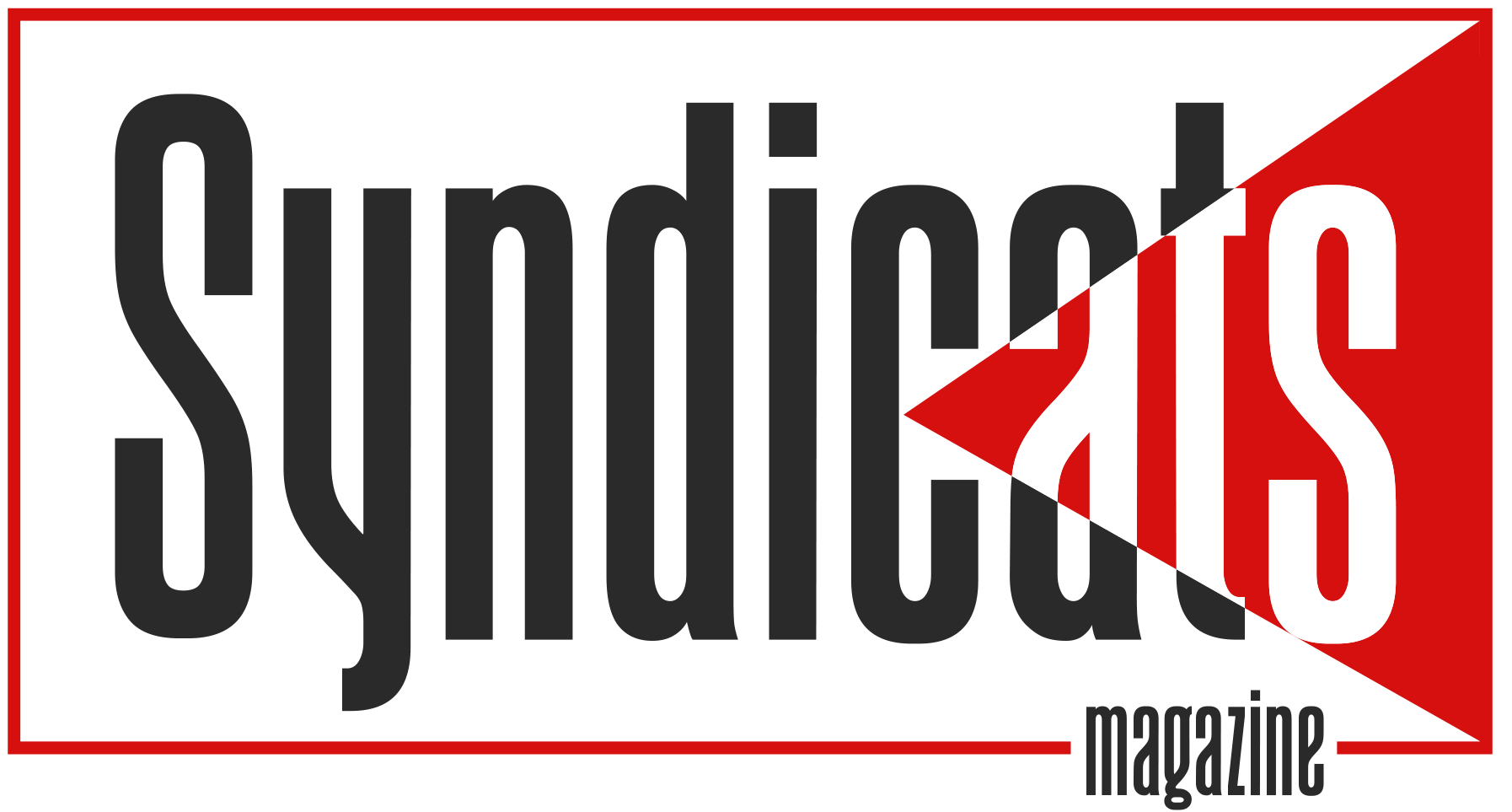






Une réaction sur “La paix, lutte permanente, lutte syndicale”