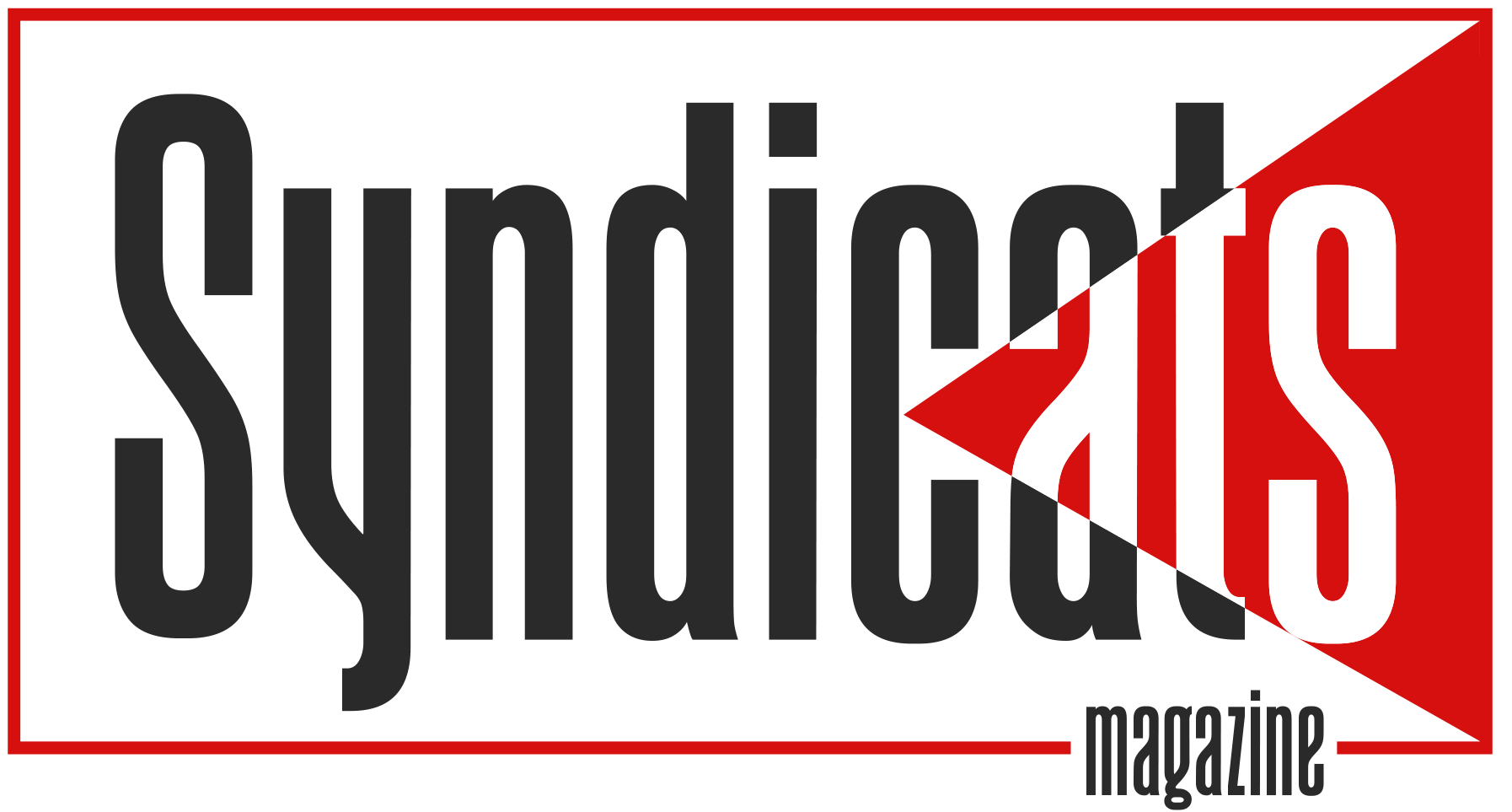Le 7 avril 2025 marque la Journée mondiale de la santé initiée par l’OMS. Elle est dédiée cette année à la santé maternelle et néonatale dans le monde. Le thème « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d’espoir ». Cette campagne mondiale vise à sensibiliser aux défis persistants en matière de santé des mères et des nouveau-nés. Elle est « l’occasion d’inviter les gouvernements et le monde de la santé à redoubler d’efforts pour mettre fin aux décès maternels et néonatals évitables, et à privilégier la santé et le bien-être des femmes à plus long terme », indique l’Organisation mondiale de la santé.
EN CHIFFRES // 300 000 femmes. 4 millions d’enfants. Chaque année dans le monde, en effet, près de 300 000 femmes perdent la vie suite à des complications liées à la grossesse ou à l’accouchement. Plus de 2 millions de nourrissons meurent avant l’âge d’un mois et on compte environ 2 millions d’enfants mort-nés par an. « Cela représente environ un décès évitable toutes les sept secondes », indique l’OMS. Les pays à faibles revenus sont évidemment les plus touchés, l’Afrique subsaharienne en tête.
En Europe en 2020, la mortalité maternelle était d’environ 12 décès pour 100 000 naissances. Le taux de mortalité infantile dans l’UE était de 3,3 pour 1 000 naissances (2,9 en Belgique) en 2022, et la mortalité néonatale avoisinait les 2 pour 1 000. Ces chiffres, même s’ils peuvent sembler peu élevés, rappellent que tous les pays doivent renforcer leurs efforts pour garantir une santé optimale dès la naissance.
Mortalité maternelle et néonatale : des causes multiples
L’OMS indique que ces décès – pour la plupart évitables avec une politique de soins adaptée – sont causés par de multiples facteurs : aux complications obstétricales directes s’ajoutent des problèmes de santé mentale non traités, des maladies non détectées, un accès difficile aux soins et vaccins, mais aussi des difficultés en termes de planification familiale. « Peu de femmes et de nouveau-nés restent dans l’établissement pendant le délai recommandé de 24 heures après l’accouchement, période pendant laquelle le risque de complications est le plus élevé. En outre, trop de nouveau-nés meurent à la maison en raison d’un renvoi précoce au domicile, de difficultés d’accès aux soins ou de la sollicitation tardive d’un avis médical. » On pointe également des manquements en matière de suivi après la naissance, lors du retour à domicile, notamment pour les enfants prématurés ou présentant un faible poids de naissance.
L’objectif: des politiques qui protègent les familles
« Les femmes et les familles devraient être appuyées par des lois et des politiques qui protègent leur santé et leurs droits », indique encore l’organisation. Des politiques qui assurent la protection financière, un accès à des soins de qualité, un soutien aux sage-femmes et au personnel soignant, une protection contre toutes les formes de violences. En bref, des politiques sociales et justes pour toutes les mères et leurs enfants.
Situation en Belgique : défis et violences économiques
Et chez nous ? En Belgique, les femmes font face à des défis économiques croissants, qui impactent directement leur santé, et dès lors celle de leurs enfants. Sur la table gouvernementale, des réformes en matière de pensions et de chômage qui auront des conséquences disproportionnées sur les femmes, notamment celles ayant des carrières morcelées ou travaillant à temps partiel. Mais aussi des attaques aux services publics, et rien, par contre, en matière de politique d’accueil des enfants. Ces mesures risquent d’aggraver la précarité des femmes, les rendant plus vulnérables à la dépendance financière, voire à l’exploitation et aux violences économiques. Avec un impact direct sur le bien-être et la santé mentale.
« Précariser les femmes tout en s’attaquant aux services publics, à la sécurité sociale, comme cet accord de gouvernement le prévoit, c’est aussi s’attaquer au bien-être des familles entières. Les reports de soins vont se multiplier, la santé – physique comme mentale – va se détériorer, et tout cela va se répercuter bien au-delà de l’individu », indiquait Selena Carbonero, juriste et secrétaire fédérale de la FGTB, dans une interview récente.
Maternité, précarité et santé mentale: la complexe équation
Car la santé mentale maternelle est un facteur clé, mais trop souvent négligé, dans la prévention de la mortalité néonatale et infantile. Des études montrent que la dépression post-partum ou la détresse psychologique, si elles ne sont pas prises en charge, peuvent compromettre la santé à la fois de la mère et du nourrisson. Les risques ? Malnutrition, maladies, retard de croissance, suivi vaccinal incomplet… Par ailleurs, le suicide figure aujourd’hui parmi les premières causes de mortalité maternelle, dans des pays comme la France, le Royaume-Uni, l’Irlande, ou encore les États-Unis. La précarité joue ici un rôle aggravant, amenant un risque de report de soins ou de difficultés d’accès à des professionnels de la santé mentale. Prendre au sérieux la santé mentale est donc une condition indispensable pour protéger les familles.
Responsabilité politique partout
L’OMS conclut en plaidant « en faveur d’investissements efficaces permettant d’améliorer la santé des femmes et des nourrissons. Il faut encourager l’action collective pour soutenir les parents ainsi que les professionnels de la santé. » Et ce, partout dans le monde.