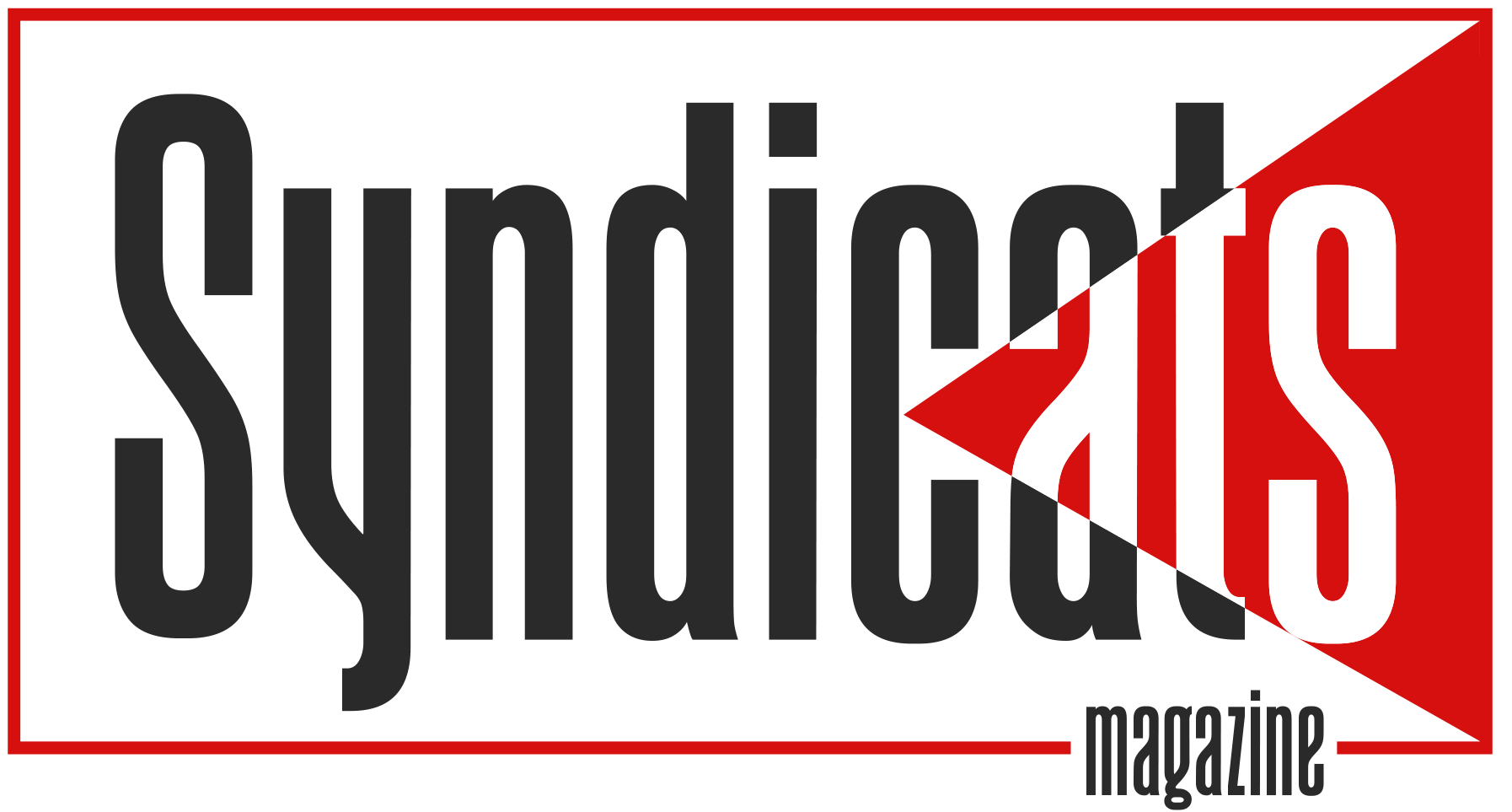Coiffeuse, caissière, aide à domicile, femme de chambre. Les métiers pénibles, Rachel Kéké les connaît. En 2019, elle en a assez. Alors qu’elle travaille pour l’hôtel Ibis Batignolles à Paris, elle et ses camarades débrayent pour de meilleures conditions salariales et de travail. La grève durera pas moins de… 22 mois. Un an après leur victoire, en 2022, Rachel Kéké fait son entrée à l’Assemblée nationale où elle siège pendant deux ans. Son ambition : défendre les travailleurs et travailleuses « invisibles ». Syndicats Magazine l’a rencontrée au festival Manifiesta.
D’Abidjan à Paris
Son parcours est rempli d’épreuves. Rachel Kéké naît en 1974 à Abidjan, en Côte-d’Ivoire, d’une mère vendeuse de vêtements et d’un père conducteur d’autobus. À l’âge de 12 ans, elle perd tragiquement sa mère. Quatre ans plus tard, elle commence à travailler comme coiffeuse pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs.
En 2000, un an après le coup d’État, elle décide de quitter son pays natal et de s’installer en France, un pays auquel elle est liée par son grand-père, qui a combattu dans ses rangs durant la deuxième Guerre Mondiale. Elle a alors 26 ans et exerce son métier dans le salon de coiffure de son oncle. Puis, elle enchaîne les métiers et situations de logement pénibles : de caissière à aide à domicile, vivant dans un squat ou chez des amis. En 2003, Rachel Kéké décroche un poste de femme de chambre à l’Ibis Batignolles, à Paris. Un hôtel aujourd’hui célèbre pour la longue lutte sociale qui y fut menée par des syndicalistes de la CGT. Elle en était la porte-parole.
Sous-traitance = maltraitance
L’interview commence fort. On lui demande quelles sont les conditions de travail qui les ont amenées, ses camarades et elle, à entamer la grève. « Qui dit sous-traitance, dit maltraitance, esclavagisme, rabaissement, mépris », nous explique Rachel Kéké. En effet, il y avait une grande différence de traitement entre les salariés et les sous-traitants. Les travailleurs et travailleuses du groupe Accor avaient des journées de travail normales, ils avaient accès au resto, des pauses pour manger, étaient mieux payés, avaient de meilleures assurances…
« En tant que femme de chambre travaillant pour la sous-traitance, c’est rare d’avoir des journées de travail de 7 heures ou plus. On travaillait 4, 5, 6 heures max. » Mais ça, c’est ce qui figurait dans leur contrat. Car en réalité, elles effectuaient des journées beaucoup plus longues. « On devait faire 40, parfois 50 chambres par jour, de 8h30 du matin jusqu’à 18h. Et les heures supplémentaires n’étaient pas payées ! Sinon, comment tu peux faire 40-50 chambres par jour et recevoir 800, 900, 1000 euros par mois ? » Si elles se plaignaient, on menaçait de les congédier. Maintenant l’on comprend mieux le terme « esclavagisme » utilisé pour décrire les conditions de travail… « Ce métier, ce sont les personnes racisées qui le font. Les femmes et hommes immigrés », explique-t-elle par ailleurs.
« Qui dit sous-traitance, dit maltraitance, esclavagisme, rabaissement, mépris. »
RAchel kéké
À tout cela s’ajoute le manque de matériel. « Nous n’avions pas de gants, ni de masques, pas assez d’aspirateurs pour toutes les travailleuses (…) Ce métier est tellement pénible qu’il donne des maladies », raconte-elle avec de l’émotion dans la voix. Tout est frais dans sa mémoire, comme si ça datait d’hier. « Mal au dos, tendinites… parce que faire une chambre en 17 minutes, ce n’est pas donné ! ». Treize femmes de chambre avaient été déclarées inaptes par le médecin du travail. L’employeur a décidé de les transférer dans un hôtel de luxe, où les conditions de travail sont, selon Rachel Kéké, encore plus dures. « C’est à ce moment-là qu’on s’est dit qu’on ne pouvait pas se laisser faire. On est parties en grève. »
Une chambre à 10.000 euros la nuit VS 250 euros de plus par mois
Plus on discute avec la syndicaliste, plus on se rend compte que la grève des femmes de chambre de l’Ibis Batignolles reflète parfaitement la lutte des classes : les travailleurs et travailleuses qui produisent les richesses VS les capitalistes qui en profitent. « Tu vois un hôtel comme l’Ibis Batignolles et tu te dis : ‘Si moi je ne travaille pas, il n’y a pas de clients. S’il n’y a pas de clients, il n’y a pas d’hôtel’. » Alors pourquoi les richesses ne sont-elles pas partagées ? Et on pourrait même aller plus loin : pourquoi les richesses ne reviennent-elles pas principalement à celles et ceux qui les produisent ?
« Pendant la grève, on avait visité un hôtel aux Champs Elysées. La seule chambre coûtait 10.000 euros la nuit. Mais quand on veut 250-500 euros d’augmentation de salaire, on doit faire une grève de 22 mois pour l’obtenir. » Oui, 22 mois. 1 an et 10 mois. Presque deux. C’est la durée du combat de Rachel Kéké et de ses 16 camarades. Mais qu’est-ce qui les a poussées à tenir si longtemps ? « La souffrance qu’on a subie. On a même une collègue qui a été violée par un ancien directeur. On est sorties du silence pour arracher notre dignité. 22 mois sous la pluie, la neige, dans la canicule. Pour qu’on nous respecte. »

« On est sorties du silence pour arracher notre dignité. 22 mois sous la pluie, la neige, dans la canicule. Pour qu’on nous respecte. »
— Rachel Kéké, porte-parole de la grève des femmes de chambre de l’Ibis Batignolles
La lutte, elle paie
« On a obtenu gain de cause sur toutes nos revendications » déclare-t-elle fièrement. « Sauf l’internalisation des travailleuses, parce qu’on était en période de Covid ». Sept personnes sont tout de même passées à 35h/semaine et la cadence de travail a baissé de 3,5 chambres par heure à 3. Elles ont également obtenu 250 à 500 euros de hausse de salaires. L’arrêt des mutations abusives vers d’autres hôtels. Du matériel pour travailler correctement – des tenues en coton parce que celles en matière synthétique brûlaient le corps quand il faisait chaud, des chaussures, le lavage des uniformes… Mais aussi 160 euros de prime de nourriture par mois, soit 7,30 euros par jour, et une pause pour manger. « Pour l’anecdote, on avait demandé 5 euros de prime, mais ils nous ont accordé une prime bien plus élevée pour qu’on arrête la grève » dit-elle en rigolant. « On a porté plainte au tribunal du travail. Ils nous suppliaient d’arrêter tout. »


Aujourd’hui, les femmes de chambre de l’Ibis Batignolles touchent 1800 à 2000 euros par mois. « C’est bien la preuve que, sur le plan purement financier, on aurait pu nous internaliser et nous protéger ». Pour Rachel Kéké, la solution pour améliorer les conditions de travail dans le secteur est simple : arrêter la sous-traitance.
Lorsqu’on lui demande quelles sont les leçons à tirer de ce combat emblématique, sa réponse est instantanée : « La lutte, elle paie. L’union, la solidarité, le courage, la détermination. Quand tu te sens humilié dans un métier, tu dois revendiquer tes droits. Personnellement, cette lutte m’a permis aussi de connaître mes droits, tenir tête au patron, parler ouvertement, refuser certaines choses que j’acceptais auparavant. Parmi les femmes qui ont participé à la grève, certaines avaient peur de s’imposer face à leur mari. Grâce à cette lutte, aujourd’hui, elles peuvent se défendre. Ça nous a ouvert l’esprit, donné du courage au lieu de subir et se taire ».
Porter la voix des sans-voix
Un an après sa victoire syndicale, Rachel Kéké est candidate aux élections législatives pour la Nupes à Paris. Elle remporte de peu une victoire face à une ancienne ministre d’un parti adverse. Rapidement, elle fait son entrée dans l’Hémicycle ; elle promet d’y défendre les travailleurs et travailleuses invisibles qu’elle a rencontrés, et dont elle a fait partie tout au long de son parcours. « Lorsque je suis arrivée à l’Assemblée nationale, la première chose qui m’a choquée, c’est l’attitude de la droite lors du débat pour l’augmentation du SMIC (salaire minimum) à 1500 euros. Je me suis dit : ‘Ils sont déconnectés de la vraie vie. Pourquoi ils ne veulent pas qu’on l’augmente ? Les gens travaillent dur.’ Ils ont méprisé la proposition et suggéré des primes à la place des augmentations de salaire. » Indignée, Rachel Kéké avait alors pris la parole : « Vous méprisez les métiers essentiels. Vous méprisez celles et ceux qui servent la France. »
Pourquoi est-il primordial d’avoir des travailleurs et travailleuses dans les instances politiques ? « À l’Assemblée nationale, nous prenons des décisions importantes. Le peuple doit être présent et en nombre. Pour faire comprendre ce qu’il vit. Parce que c’est lui qui pourra le mieux parler de sa condition, défendre ses droits. Dans la tête des gens, si tu n’as pas fait d’études, tu ne peux pas être ministre, sénateur… C’est faux ! Tout le monde peut faire de la politique. Une femme de ménage, un éboueur, un agriculteur, un conducteur de train… ». Et elle conclut sur le rôle de l’État : « Il devrait être là pour tous. Il doit protéger ceux qui se lèvent tôt et n’arrivent pas à boucler les fins de mois. »
L’union fait la force
Pour terminer l’interview, nous lui avons posé quelques questions sur la situation politique actuelle. Concernant la percée de l’extrême droite, elle pointe du doigt notamment le rôle des médias : « On fait peur aux gens. On leur dit que c’est l’immigré qui prend leur travail, qui cause l’insécurité, que tous les problèmes de la France sont dus à l’immigration… Alors que c’est notamment les immigrés qui font tourner l’économie. Dans les homes, qui s’occupe des personnes âgées ? »
Pour Rachel Kéké, la réponse à donner à la montée de l’extrême droite, c’est l’union de la gauche. « L’union fait la force ! » nous dit-elle en souriant et en faisant allusion à la victoire du Nouveau Front Populaire, la coalition des partis de gauche qui a battu l’extrême droite aux dernières élections françaises. Mais selon elle, avec la nomination d’un Premier ministre d’un parti qui a récolté à peine 5%, Macron ne respecte pas le vote des citoyens. « C’est aux français qui ont donné la majorité à la gauche de ressortir dans la rue et dire à Macron de respecter leur vote. » Et c’est ce qu’ils ont fait. Les mobilisations en France continuent à ce jour.