Si les violences physiques et sexuelles sont régulièrement au cœur du débat et –fort heureusement – reconnues comme des urgences sociétales, une autre forme de violence reste largement ignorée : la violence économique. Invisible, mais bien présente, elle enferme des milliers de femmes, en Belgique et ailleurs, dans la dépendance et la précarité. Et les logiques néolibérales et conservatrices du gouvernement Arizona risquent d’en rajouter une vilaine couche.
Un pouvoir sur le portefeuille, un contrôle sur la vie
De quoi parle-t-on vraiment? D’une tendance à enfermer des personnes – le plus souvent, des femmes – dans une précarité organisée de telle sorte qu’aucune porte de sortie ne soit accessible. Dans une étude commune, les instituts Soralia et Sofelia indiquent ceci: « les violences économiques consistent à priver une personne de ses ressources financières, à l’empêcher d’accéder à son propre argent, à la placer dans une situation de dépendance ou à contrôler ses dépenses. ». Elles se manifestent aussi bien dans la sphère privée (contrôle des revenus par le conjoint, privation de moyens financiers, non-paiement des pensions alimentaires) que dans le monde du travail. « La précarité, les bas salaires, les temps partiels imposés, les pensions dérisoires, autant de mécanismes qui enferment les femmes dans la dépendance et la vulnérabilité », indique quant à elle la FGTB.
« Réduire les droits des femmes à la pension, à un job de qualité, à des services d’accueil, c’est créer de la précarité, de la dépendance. Et c’est aussi revenir à une certaine forme de violence, voire à un risque d’exploitation économique. C’est un retour en arrière sur des décennies de luttes féministes, un recul en termes d’émancipation, alors qu’il faudrait au contraire renforcer ces conquis. »
Selena Carbonero, Secrétaire fédérale FGTB
Dans le cercle familial, les violences économiques peuvent survenir au sein du couple, ou lors d’une séparation: l’agresseur privant sa victime de moyens de prendre son indépendance ou de subvenir à ses besoin, ou à ceux de ses enfants. « En 2022, 47 % des parents qui devaient recevoir une pension alimentaire ne la recevaient pas », indique la plateforme Mirabal. « Cela signifie que quasiment la moitié des parents séparés subissent des violences économiques de la part de l’autre parent. Il est urgent d’intégrer la violence économique dans la législation belge afin d’offrir une meilleure protection aux victimes. »
Violence gouvernementale
Dalila Larabi, experte des questions de genre à la FGTB, élargit immédiatement le cadre : la violence économique ne se limite pas au foyer ou au couple. Elle s’inscrit aussi dans les réformes et les choix politiques.

« Oui, on parle de violence économique à l’intérieur d’un couple, mais il existe aussi des violences institutionnelles, qui frappent spécifiquement les femmes. Le gouvernement Arizona ne fait que ça! Il limite l’indépendance des femmes et accentue leur précarité. La domination patriarcale devient à la fois intrafamiliale et sociétale. »
— Dalila Larabi, Service genre de la FGTB
Une violence dont les effets ne se limitent pas aux femmes. « Appauvrir les femmes, c’est appauvrir les enfants, les hommes, les familles, et par conséquent la société entière. En parallèle, les politiques de gendermainstreaming, donc qui tentent de répondre à ces enjeux, seront définancées au niveau régional. Les organisations progressistes doivent absolument prendre cette problématique en main. La manifestation du 23 novembre, organisée par la plateforme Mirabal, a spécifiquement ciblé cet aspect des choses. »
Discriminations multiples
Le gouvernement joue sur un terrain déjà inégal. « On le sait, de nombreuses femmes n’ont pas de carrières complètes. Soit elles se trouvent dans une situation familiale qui leur impose une mauvaise répartition des tâches – et sont donc contraintes au temps partiel – soit elles sont parent solo, et c’est très difficile dans ce cas de travailler à temps plein. Ces femmes-là seront les premières à perdre tout filet de sécurité. On va pénaliser, en bref, celles qui le sont déjà. »
Car ce cumul d’obstacles — charge mentale, difficultés de trouver une place en crèche, horaires scolaires versus flexibilité du travail — se traduit par des carrières hachées, aujourd’hui dans le viseur des réformes gouvernementales. « Suppression ou réduction des périodes assimilées, accès plus strict à la pension, réforme du chômage, flexibilité accrue, travail de nuit moins rémunéré… La liste est longue. Ajoutons à cela la ségrégation horizontale », poursuit Dalila Larabi. « Les métiers dits féminins sont non seulement pénibles, tant pour la santé physique que mentale, mais aussi moins rémunérés. » Autrement dit: moins bien payées aujourd’hui, moins bien protégées demain.
Flexibilité incompatible avec la vie privée
Les discours gouvernementaux valorisent la flexibilité comme une forme moderne du travail. Dans les faits, on le sait, elle renforce les inégalités. Particulièrement dans les foyers monoparentaux ou les familles où la charge de soin retombe principalement sur les mères. « Encore une fois, les femmes vont y perdre. L’augmentation des heures sup’, par exemple, va peser lourd sur les vies de familles. On imagine déjà les périodes de fête dans certains secteurs, où les heures supplémentaires vont exploser. Alors que les enfants sont en congé. Pour de nombreuses femmes, il ne sera plus possible de rentrer – ou de rester – sur le marché du travail, car ce sera incompatible avec la vie de famille. »
« Salaire d’appoint »
Dalila Larabi parle d’une aggravation du modèle du « salaire d’appoint » au sein de nombreux ménages. « Perte des droits au chômage, travail de nuit moins bien payé, pension amputée, diminution des périodes assimilées: autant d’éléments qui pèsent directement sur les revenus des femmes. Pour celles qui sont cohabitantes, cela signifiera un basculement brutal dans la dépendance économique. Pour d’autres, ce sera le retour du salaire d’appoint, le « petit salaire » du couple. On sait alors comment ça se passe: Monsieur, qui a le plus gros revenu, achète la voiture, et Madame paie les courses alimentaires avec ce dont elle dispose. Ce qui signifie qu’en cas de séparation, Madame n’a plus rien, parce que le contenu du caddy, on l’a mangé ». Les mesures de l’Arizona risquent donc de recréer exactement les mécanismes de dépendance que les mouvements féministes et syndicaux avaient mis des décennies à faire reculer.
Inégalité structurelle
En bref, résume Dalila Larabi, « on se rend compte qu’une inégalité structurelle entre les femmes et les hommes est en train de se mettre en place, sous le gouvernement Arizona. Les politiques d’égalité sont démantelées alors même que la Belgique a signé en 2016 la Convention d’Istanbul, qui reconnaît les violences économiques. » Un paradoxe inquiétant.
Les solutions, quelles sont-elles? « Le gouvernement évoque bien le crédit familial ou “sac à dos”, mais on voit bien dans les statistiques de l’ONEM que ce sont les femmes qui mettent leur carrière entre parenthèse pour le soin aux enfants. Je doute dès lors que le crédit familial ‘sac à dos’ va améliorer la vie des femmes. »
Les revendications sont claires : « il faut continuer à pousser à la suppression du statut cohabitant, l’individualisation des droits sociaux et la réduction collective du temps de travail comme véritables leviers d’égalité. »
Les réformes actuelles risquent d’institutionnaliser la violence économique et les discriminations. Les organisations syndicales et féministes avertissent : il est urgent de remettre l’égalité au centre des politiques publiques. Rendez-vous le 23 novembre à Bruxelles, pour la manifestation « Mirabal ».




Action contre les violences faites aux femmes lors du Comité fédéral de la FGTB, le 21 octobre 2025.
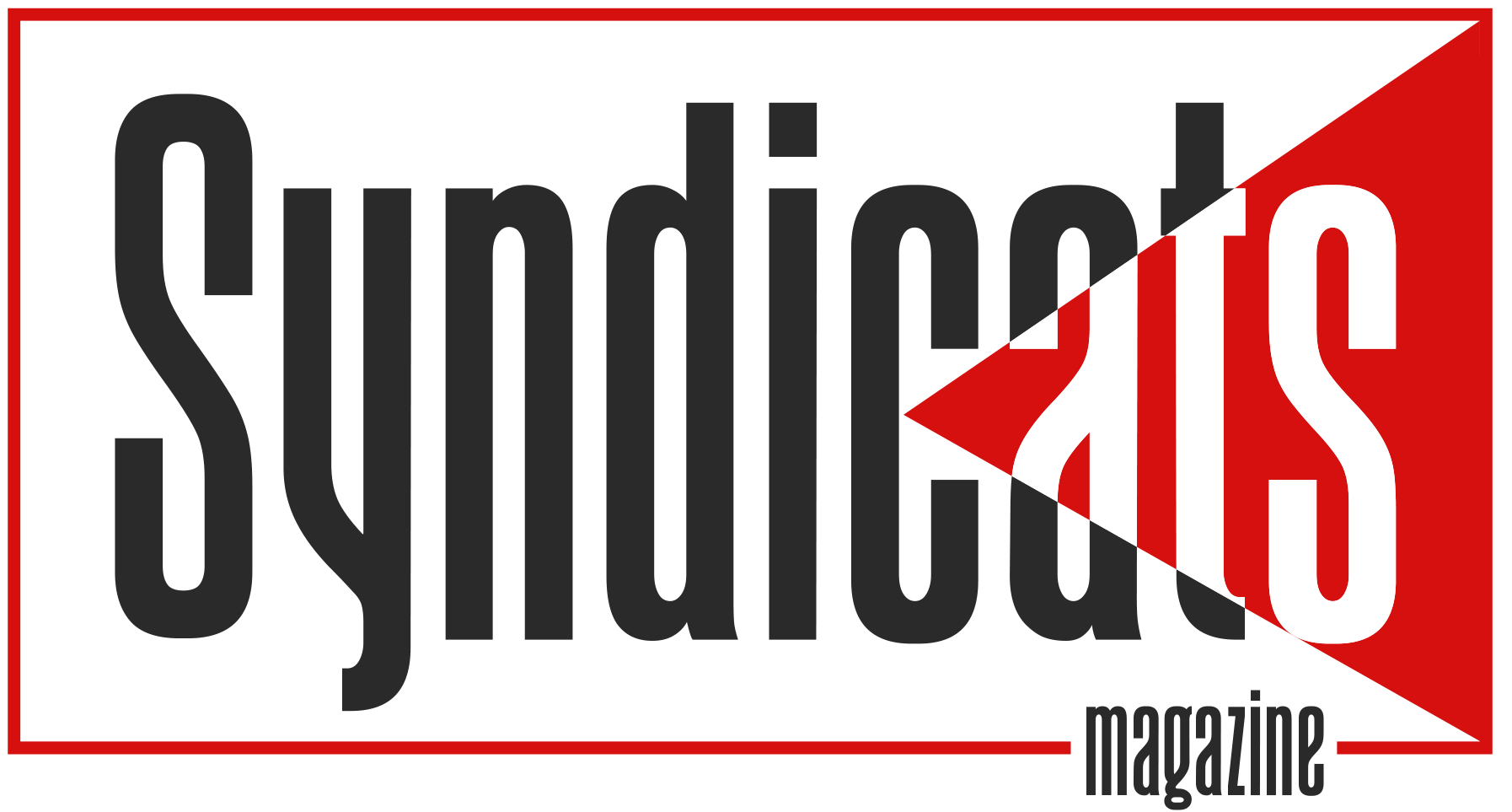






Une réaction sur “Violences économiques : l’attaque silencieuse contre les femmes”