Quatre-vingts ans après la libération des camps nazis, l’histoire de Breendonk reste une plaie ouverte de la collaboration belge. Dans l’ouvrage Vandaag ik, morgen jij (Aujourd’hui moi, demain toi), l’avocat et auteur Jos Vander Velpen se penche sur cette période sombre de l’histoire belge. À travers les destins croisés de deux jeunes résistants et de deux SS flamands, il dresse un portrait de la résistance et de la collaboration. Rencontre.
Avocat de renom, Jos Vander Velpen s’est fait connaître pour avoir obtenu, en 2004, la condamnation du Vlaams Blok pour violation de la loi Moureaux contre le racisme et la xénophobie. Plus récemment, il a également été impliqué dans le procès contre Dries Van Langenhove et le mouvement d’extrême droite Schild & Vrienden.
La lutte contre la discrimination et l’extrême droite constitue ainsi le fil rouge de sa carrière. Après avoir déjà consacré deux ouvrages au camp de Breendonk, il y revient une troisième fois, poursuivant son travail de mémoire sur le camp de prisonniers belge le plus tristement célèbre de l’occupation nazie.
Le résultat n’est pas un roman, mais une reconstitution rigoureuse, fondée sur des archives judiciaires, des témoignages et les souvenirs des protagonistes. Divisé en trois parties – rouge, blanc et noir –, l’ouvrage retrace les heures les plus noires de l’occupation, tout en mettant en lumière des gestes de courage, de solidarité et d’espoir face à la barbarie.
Quelle était votre motivation personnelle pour écrire ce livre ?
Jos Vander Velpen : « Breendonk reste l’une des pages les plus sombres de notre histoire. Quatre mille personnes y ont été emprisonnées. La moitié n’a pas survécu. Pourtant, cette tragédie est passée sous silence pendant des décennies, en particulier après le début de la guerre froide. On peut parler d’une forme d’amnésie collective, voire de falsification délibérée de l’histoire. L’extrême droite tente d’effacer Breendonk de la mémoire collective ou de minimiser la collaboration. C’est précisément pour cette raison que je ressens le devoir moral de raconter à nouveau son histoire. Les nouvelles générations en savent souvent trop peu à ce sujet. L’histoire a également perdu de son importance dans l’enseignement. Alors que cela devrait constituer un pilier fondamental de la formation citoyenne. »
« L’extrême droite tente d’effacer Breendonk de la mémoire collective ou de minimiser la collaboration. »
Jos Vander Velpen, auteur de « aujourd’hui moi, demain toi »
Se mettre dans la peau d’autrui
Votre livre donne la parole non seulement aux victimes, mais aussi aux bourreaux. Pourquoi avez-vous fait ce choix ?
« Je décris la vie de deux gardes de camp SS flamands tristement célèbres : Fernand Wyss et Richard De Bodt. Leurs atrocités ont été largement documentées lors des procès d’après-guerre. Ensemble, ils ont été responsables de dizaines de meurtres, de tortures et d’exécutions. Ils ont commis des actes abominables, mais je refuse de les qualifier de ‘monstres’. C’étaient des êtres humains, et c’est précisément pour cette raison qu’ils portent une responsabilité.
Personne n’a obligé Wyss à pousser un prisonnier dans le fossé ou à le lapider. Ceux qui pensent en termes de ‘monstres’ mettent fin à toute analyse et à tout débat. Il est important de comprendre comment des êtres humains sont capables de commettre de tels actes. C’est la seule façon d’en tirer des leçons. »
Vous utilisez la première personne pour les résistants, et la troisième personne pour les collaborateurs. Pourquoi ce choix ?
« J’ai personnellement connu Jan Van Calsteren et Marcel Arras, et j’avais accès à leurs notes, à leurs témoignages. Cela m’a permis de reconstituer leur vie à travers leur propre voix. Je ne disposais pas de ces sources pour les SS. Mais même si je les avais eues, je n’aurais pas voulu parler avec leur voix. Non pas parce que je veux les déshumaniser, mais parce que je ne veux pas m’identifier aux auteurs. Je veux montrer que c’étaient des êtres humains qui ont commis des actes inhumains. Ce qui est différent que les présenter comme des ‘monstres’ ou des ‘caricatures.’ »



Images de la commémoration annuelle du 8 mai au fort de Breendonk (2025)
Vous évoquez les petites et grandes formes de résistance. Quelle était l’importance de ces actes symboliques ?
« La résistance commence toujours modestement. Personne ne fait exploser une caserne du jour au lendemain. Elle commence par des gestes symboliques. Pendant l’occupation, le 21 juillet, Jan Van Calsteren se promenait au centre d’Anvers avec trois crayons aux couleurs du drapeau belge. Quand un membre de la Brigade noire – un groupe collaborateur – l’a interpellé, il lui a tendu le crayon noir en disant ‘c’est celui qui vous convient le mieux’. Cela peut sembler anodin, mais c’est un acte de résistance. Plus tard, il a mené des actions plus risquées, pour lesquelles il a été arrêté à plusieurs reprises, envoyé à Breendonk et même à Dachau.
La résistance commence toujours modestement. Personne ne fait exploser une caserne du jour au lendemain. Elle commence par des gestes symboliques.
Nous oublions aussi trop souvent le rôle des femmes : comme coursières, dactylos et organisatrices. La petite amie de Jan a fini à Ravensbrück, un camp de concentration pour femmes, parce qu’elle transmettait des messages. Ce type de travail était moins visible, mais crucial. La résistance était plus large et plus diversifiée qu’on ne le raconte souvent. »
Quelles leçons pouvons-nous tirer du passé ?
« La liberté et la démocratie ne vont jamais de soi. Dans les années 1930, personne n’imaginait qu’une décennie plus tard, tous les droits seraient abolis. Aujourd’hui encore, nous voyons des mouvements d’extrême droite tourner le passé en dérision, minimiser l’Holocauste et utiliser sans vergogne des symboles nazis. Les libertés sont fragiles, éphémères. En ce sens, le livre est aussi un avertissement. Chaque génération doit se battre pour préserver la démocratie et la liberté. »
Le procès du siècle
En tant qu’avocat, comment percevez-vous les procès qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ?
« J’ai été vraiment surpris par la rigueur avec laquelle ces procès ont été menés. Juste après la guerre, avec des moyens limités, la justice a fait comparaître plus de 450 (!) témoins dans le procès de Breendonk. Sans ces dossiers, je n’aurais tout simplement pas pu écrire ce livre. L’ensemble du procès reste un travail titanesque d’importance historique.
Bien sûr, des erreurs ont été commises et il y a eu des traitements différents pour des faits similaires : ceux qui ont été jugés immédiatement après la guerre ont souvent écopé de peines plus lourdes que ceux dont le procès n’a eu lieu que des années plus tard. De Bodt, par exemple, a vécu caché en Allemagne pendant des années avant d’être jugé. Sa peine de mort prononcée par contumace a été commuée en travaux forcés à perpétuité. Il est décédé en 1975 dans la prison de Saint-Gilles. Wyss a été exécuté par un peloton d’exécution en 1947. »
Avez-vous un lien personnel avec cette histoire ?
« Je viens d’un petit village du Hageland, près de Saint-Trond. Mes parents étaient agriculteurs et ne faisaient pas partie de la résistance, mais plusieurs jeunes de ma famille oui.
Plus tard, j’ai découvert qu’il y avait eu plus de collaboration dans mon village que je ne l’imaginais. Certaines personnes ont même été condamnées après la guerre.
Mais pour moi, cela est devenu vraiment personnel lorsque j’ai retrouvé dans les dossiers le nom de notre médecin de village. Il avait survécu à Breendonk. Après la guerre, il est venu s’installer dans notre région pour se remettre de ce qu’il avait vécu là-bas. Je lui ai dédié un précédent livre. Cela montre à quel point cette histoire nous touche de près. »

Pour écrire ce livre, vous avez lu des milliers de pages de témoignages et de documents judiciaires. Est-ce parfois difficile sur le plan émotionnel ?
« Cela a été difficile par moments, c’est certain. On essaie de comprendre… Dans ma carrière d’avocat, j’ai été confronté à beaucoup de violences, de meurtres et d’homicides, ce qui m’a en quelque sorte armé. Mais l’horreur de Breendonk reste incompréhensible. Comment un être humain peut-il être aussi cruel ? Et en même temps, comment peut-il faire preuve d’un tel courage et d’une telle solidarité ?
Je me suis parfois demandé : aurais-je été capable de garder le silence sous la torture ? On ne peut pas le savoir sans l’avoir vécu. C’est pourquoi j’essaie d’écrire sans trop de pathos ou d’émotion : les faits parlent d’eux-mêmes. Ils sont déjà suffisamment bouleversants. »
Quel est le message central que vous souhaitez transmettre avec « Aujourd’hui moi, demain toi » ?
« Que la liberté est fragile. Breendonk montre à quelle vitesse tout peut disparaître. Le titre du livre vient d’une phrase écrite par un prisonnier, qui résume parfaitement la situation : tout le monde peut devenir victime. C’est exactement pour cette raison que nous devons rester vigilants et nous opposer à toute atteinte à la démocratie et à l’État de droit. »

« La liberté est fragile. (…) C’est exactement pour cette raison que nous devons rester vigilants et nous opposer à toute atteinte à la démocratie et à l’État de droit. »
— Jos Vander Velpen, Auteur de « Aujourd’hui moi, demain toi »
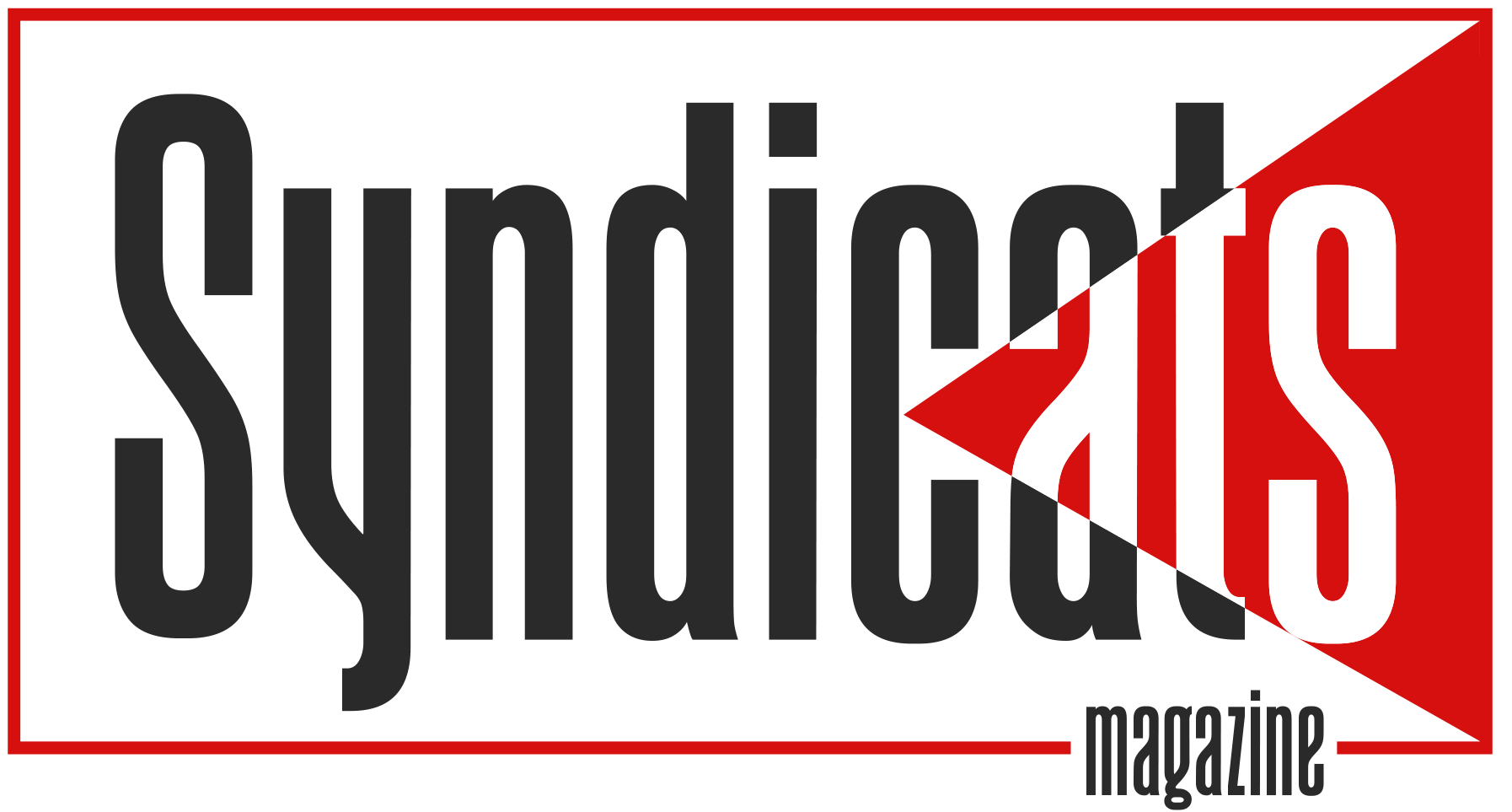






Est ce que cela est aussi en français