Ces derniers jours, les malades de longue durée se retrouvent une fois encore au centre d’une polémique. À la suite de la fuite d’une note interne de l’INAMI, plusieurs responsables politiques de droite pointe du doigt celles et ceux qu’ils appellent scandaleusement « les faux malades ». L’expression a fait le tour des plateaux télé. De quoi parle-t-on vraiment ? Débunkage.
Une note technique devenue outil politique
Le document à l’origine de la controverse ne visait pas à dresser un constat général sur tous les malades de longue durée. Il s’agissait d’un contrôle thématique, un exercice régulier du service Indemnités de l’INAMI destiné à évaluer le travail des médecins-conseils des mutualités. Le contrôle portait sur un groupe spécifique : les personnes dont l’incapacité de travail avait été prolongée jusqu’à l’âge de la pension.
Rétablissons les faits.
Des échantillons de deux « sous-groupes » ont été analysés. Premièrement, les personnes présentant une pathologie qui donne automatiquement droit à une incapacité de travail jusqu’à l’âge de la pension. Il s’agit des maladies graves, permanentes. Dans 130 des 136 cas contrôlés (soit 95 % !), la reconnaissance jusqu’à l’âge de la pension a bien été confirmée. Bien entendu, ce chiffre n’est pas mentionné par la droite dans ses sorties médiatiques.
« Quand Clarinval affirme qu’un quart des malades seraient des « faux malades », c’est de la manipulation des mots et des chiffres.
Selena Carbonero
Deuxièmement, le sous-groupe des gens qui ne présentent pas ce type de pathologie « irréversible », mais qui pourtant avaient vu leur incapacité prolongée jusqu’à la pension. C’est là que le Ministre Clarinval trouve « ses chiffres ». Effectivement, on lit que chez ces personnes, dans 27,2 % des cas, l’invalidité a finalement été supprimée. Est-ce que cela fait d’eux de « faux malades » ? Non. Le discours doit être nuancé. Il s’agit d’un échantillon ciblé, utilisé aujourd’hui de manière abusive pour justifier un discours d’austérité.
« On est à nouveau dans la stigmatisation d’une partie de la population. Clarinval détourne des résultats qui ne confirment pas du tout ses propos! Il affirme qu’un quart des malades seraient des « faux malades », c’est de la manipulation des mots et des chiffres », indique Selena Carbonero, secrétaire fédérale de la FGTB.
Une fuite qui sert un agenda budgétaire
La réalité, quelle est-elle? Elle est plus nuancée.
L’échantillon contrôlé date d’avant un changement de réglementation, mis en œuvre l’an dernier, qui introduit des durées précises pour l’incapacité de travail. Résultat, aujourd’hui, il n’arrive plus que très rarement que des personnes soient reconnues en incapacité jusqu’à la pension.
Ensuite, la droite reproche aux mutualités d’avoir « accordé » des prolongations d’invalidité par le passé, sans tenir compte de certaines possibilités de requalification professionnelle ou d’amélioration de l’état de santé. Un prétexte pour accuser les mutualités de ne pas bien faire leur travail… Mais aussi de masquer deux réalités. D’une part, la pénurie chronique de médecins-conseils – conséquence directe d’années d’économies et d’un statut peu attractif – et d’autre part, la cadence imposée par la réforme de l’incapacité de travail, avec ses contrôles à répétition. Cadence qui sera encore accrue au premier janvier 2026, avec la mise en place d’un suivi plus strict des malades de longues durées.
Par ailleurs, nous souffle-t-on du côté des mutualités, une partie du « contrôle » incriminé portait sur des travailleurs atteints d’une pathologie mentale. Que ce soit un burn-out ou un autre trouble, l’interprétation médicale, ici, peut varier en fonction de nombreux facteurs.
Pour la FGTB, il ne fait guère de doute que cette note a été délibérément mise en avant, dans un contexte politique tendu. Le gouvernement Arizona cherche à réaliser de nouvelles économies, et les malades apparaissent comme une cible commode. Tout en n’oubliant pas, au passage, d’égratigner le travail mené par les mutualités et les médecins-conseil.
Le vrai débat : ce qui rend les travailleurs malades
La polémique actuelle détourne le regard du fond du problème. Plutôt que de s’interroger sur les causes de la hausse du nombre de malades de longue durée — conditions de travail pénibles, horaires atypiques, précarité, stress, intensification des tâches — le gouvernement préfère s’en prendre aux malades eux-mêmes.
« On détourne l’attention des causes des problèmes de santé des gens, pour ensuite, en plus, aller les sanctionner quand ils voudront accéder à la pension ! », résume Selena Carbonero.
Pourtant, les effets des politiques d’austérité sont bien documentés : une santé fragilisée, un équilibre vie privée–vie professionnelle brisé, une précarité accrue. Les femmes en sont souvent les premières victimes, tout comme les travailleurs âgés.
Responsabiliser les employeurs
En parallèle, les employeurs restent à l’abri. Les PME sont exclues de nombreuses obligations, tout comme les entreprises, peu responsabilisées en matière d’incapacités, notamment pour les plus de 55 ans.
Pourtant, « responsabiliser les employeurs est essentiel », indique-t-on du côté des services d’étude de la FGTB. « Ce sont eux, en effet, qui doivent adapter le poste de travail afin de permettre à une personne en incapacité de le réintégrer. Une enquête menée par Kom op tegen Kanker révèle que 57 % des employeurs ne disposent toujours pas d’une politique collective de réintégration, alors que cette obligation existe depuis déjà trois ans. »
Ce sont également les employeurs qui ont un rôle à jouer dans l’embauche de personnes encore convalescentes ou ayant connu la maladie. Or, selon la même enquête, 84 % des personnes malades déclarent s’être senties discriminées lors d’une candidature en raison de leur état de santé.
D’abord les chômeurs, puis les malades. Et après?
Pour les malades de longue durée, aujourd’hui, la situation est anxiogène. La santé mentale, peu prise en compte ici, en prends un coup. Parallèlement, d’autres mesures envisagées par l’Arizona menacent les pensions futures. Résultat? Un avenir incertain, qui vient nourrir un sentiment d’insécurité sociale. Car derrière les chiffres, ce sont des parcours de vie bouleversés, parfois des traitements longs, des familles inquiètes.
Ce que l’on constate aujourd’hui, une nouvelle fois, c’est qu’un chiffre est détourné de son objet premier pour en faire une généralité. Et alimenter la suspicion dont les malades font l’objet aujourd’hui. « Il y a eu les ‘chômeurs profiteurs’, maintenant il y a les ‘faux malades’. À qui le tour, après ça ?» Pendant ce temps, on détourne les yeux des « vrais responsables » du manque de recettes : ceux qui ne contribuent pas à la solidarité.
Derrière cette opération de communication se dessine un choix politique. Celui d’une société qui se détourne de toute forme de solidarité, et qui continue, jour après jour, d’agresser les plus fragiles d’entre nous.
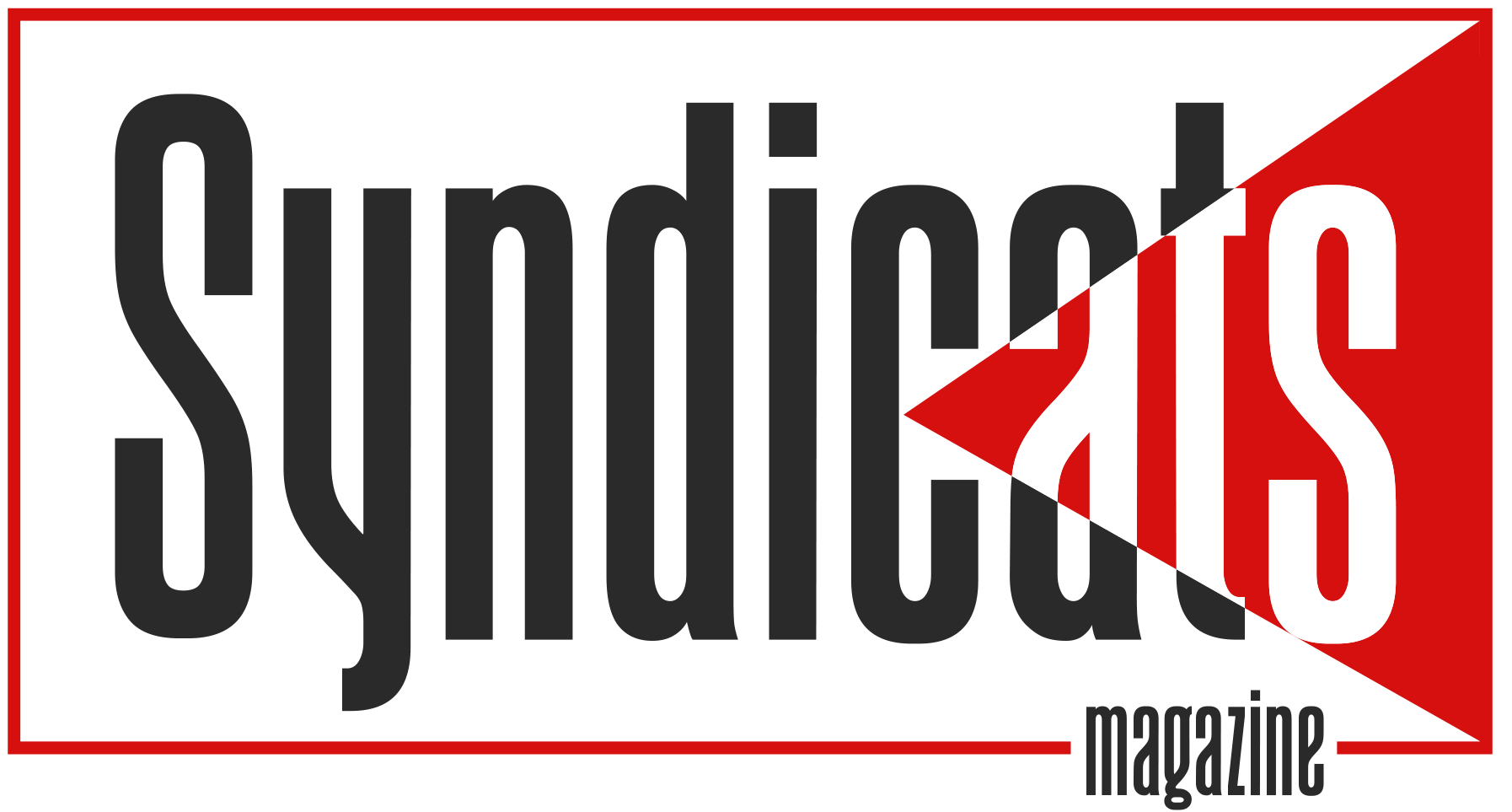






Je suis une malade de longue durée. J’ai voulu entreprendre à plusieurs reprises une formation de réinsertion professionnelle afin de pouvoir retourner au travail. À cause de ma santé, je n’arrive pas au bout, pas que je ne veux pas mais ma santé me lâche. Le médecin conseil trouve ma santé trop fragile!
Je ne suis pas une fausse malade, je ne demanderais pas mieux de retravailler.
Mes chers camarades, je ne saurai être présent lors de la manifestation, mais sachez que je suis de tout coeur avec vous, quand je vois « faux malades » cette expression me révulse, les malheureux qui vont êtres exclus du chômage ne sont pas des « paresseux » simplement si les industriels relocalisaient chez nous ou au moins en Europe, mais ils préfèrent employer des esclaves pour leurs productions, ne nous y trompons pas, les pays « sous-développés » sont surtout surexploités et je pense que cette horreur doit cesser, le monde est un village et quand je jette un litre d’huile à la mer (c(est une image) et bien ce geste est nocif tant pour un africain, qu’un européen. Il est plus que temps de se réveiller et d’enfin considérer que les gens ont le droit de vivre chez eux dans le bonheur et sans être obligé de venir ou de rester sur place mais traiter comme des sous-hommes. Je ne suis pas très instruit, mais pour moi un humain est un humain. J’espère qu’ensemble nous arriverons enfin a notre but, le bonheur tout simplement