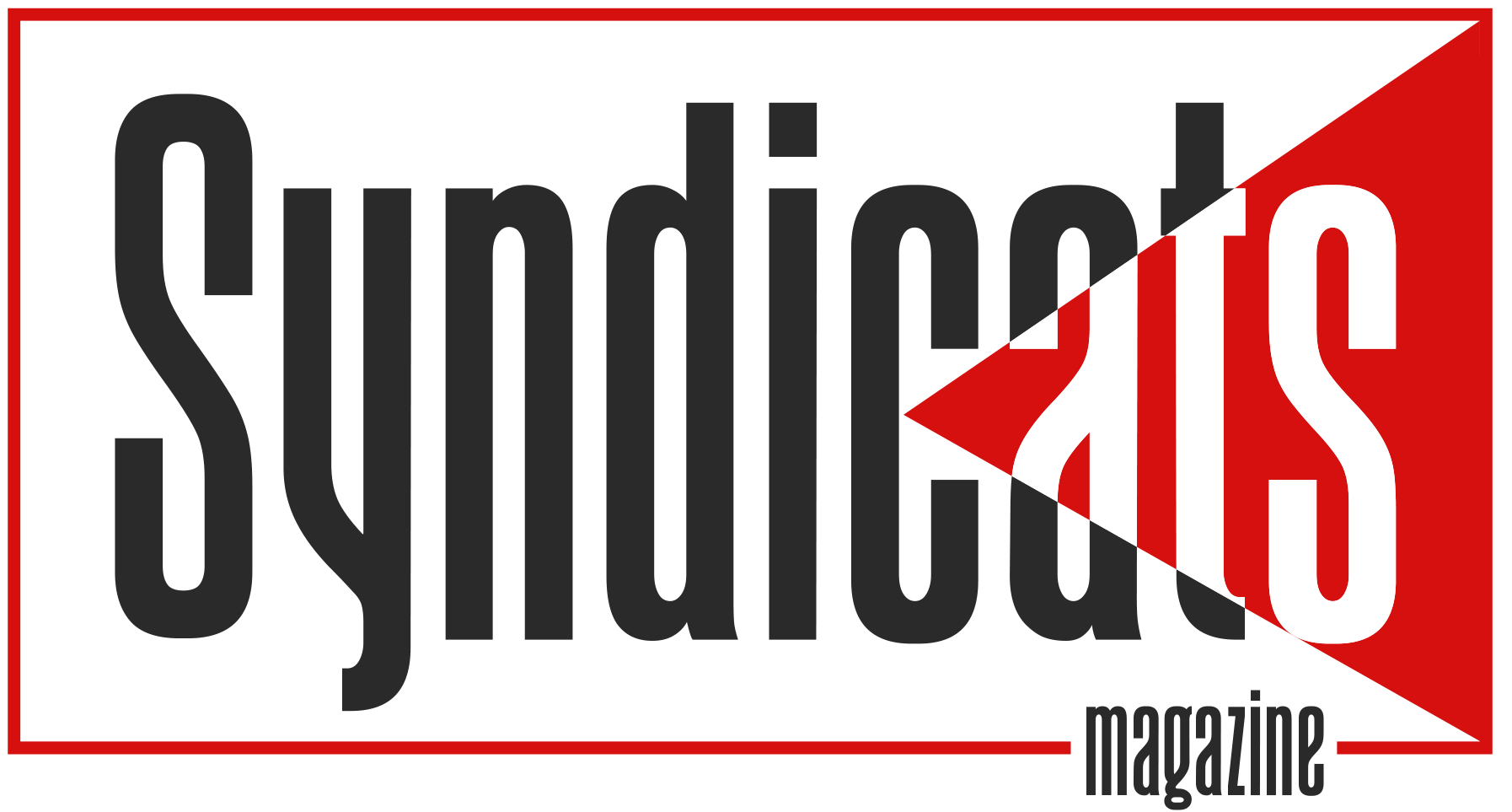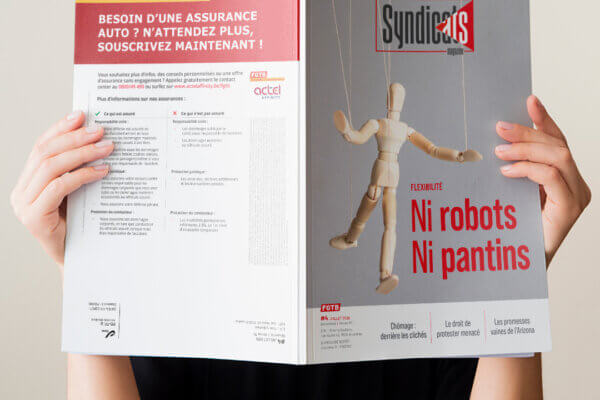Théories délirantes sur la séduction et la supériorité de l’homme sur la femme, négation des violences conjugales et de genre, contestation du droit des femmes à disposer de leur corps… Les discours masculinistes pourraient presque prêter à sourire s’ils ne menaient pas au pire. On pense notamment au harcèlement en ligne, aux actes de vandalisme et agressions mais aussi au massacre de Polytechnique Montréal en 1989, à la tuerie d’Isla Vista en 2015 ou encore au meurtre de Mélanie Ghione en 2020… Les théories mascus tuent. Les combattre est aujourd’hui plus qu’une urgence.
Les états généraux féministes
Comme chaque année, le CEPAG organise les États généraux féministes : des rencontres pour faire le point et échanger autour des droits des femmes et des défis qui s’imposent aux mouvements féministes. Et, parmi ceux-ci, le masculinisme est dans le peloton de tête. Pour mieux combattre cette mouvance, il est indispensable de l’analyser et d’en identifier les stratégies. C’est précisément ce à quoi se sont attelés les participants et participantes à la deuxième journée des États généraux féministes 2025, le 5 juin dernier. Cette journée, qui affichait complet, a réuni un public militant, des académiques ainsi que des acteurs et actrices de terrain.
Deux intervenants apportaient leur éclairage pour alimenter le débat : Florence Hainaut, journaliste et réalisatrice, et Renaud Maes, docteur en Sciences sociales et politiques de l’ULB.
Qui sont les masculinistes ?
Le masculinisme se construit comme un contre-discours face aux progrès de l’égalité » a expliqué Renaud Maes. Il repose sur deux piliers : le rejet des acquis féministes et l’idée d’une perte de repères des hommes dans une société qui évoluerait trop vite.
Le chercheur distingue trois principaux courants au sein de ce mouvement :
- Les anti-féministes, qui considèrent le féminisme comme responsable de leur malaise identitaire.
- Les suprémacistes blancs, qui combinent misogynie, racisme et nostalgie d’un ordre patriarcal.
- Les incels (involuntary celibates, ou célibataires involontaires), qui estiment que le consentement
empêche les hommes d’accéder à des relations « authentiques ».
Le cyberespace est une guerre de territoire.
renaud maes, docteur en Sciences sociales et politiques de l’ULB
Les stratégies d’influence des masculinistes
Florence Hainaut est revenue sur la manière dont les contenus masculinistes gagnent en visibilité. Les réseaux sociaux, via leurs algorithmes, favorisent les discours clivants et violents. Certains contenus sont assumés, agressifs, d’autres plus subtils, presque banals, mais tout aussi efficaces pour infiltrer les imaginaires. En montant en épingle des situations individuelles difficiles (droits de garde d’enfants, isolement social, hommes violentés ou discriminés), certains groupes jouent sur l’émotionnel, en utilisant une stratégie populiste qui se focalise sur les souffrances personnelles d’hommes en perte de repères pour emporter l’adhésion.
Renaud Maes a complété cette analyse en mettant en avant, et en dénonçant, une stratégie de ciblage générationnel : les adolescents en quête d’identité, les hommes actifs en souffrance professionnelle et les seniors séduits par le discours nostalgique du « c’était mieux avant ». Une stratégie qui joue sur une certaine vulnérabilité pour tisser un sentiment d’appartenance viriliste.

« Internet n’est pas un lieu de violence, mais son veceur ».
— Florence Hainaut, journaliste et réalisatrice
Le cyberharcèlement anti-féministe
Le cyberharcèlement antiféministe, trop souvent banalisé, constitue une composante centrale de ces mouvements. Lorsqu’un groupe masculiniste se rend physiquement à une audience judiciaire, comme ce fut le cas pour Florence Hainaut, il transforme la violence numérique en pression directe sur les institutions. Cette dernière perçoit le développement d’un narratif masculiniste — fondé sur une représentation vénale et hystérique de la femme — comme un backlash (retour de bâton) au mouvement #MeToo.
Cette thèse du backlash a fait l’objet de débats avec les participantes et participants. Renaud Maes, par exemple, la relativise quelque peu. Selon lui, les discours masculinistes puisent leurs racines dans des textes remontant aux années 1970. Il alerte également sur leur infiltration insidieuse au sein de certains partis politiques belges – et ce, malgré l’existence d’un double cordon sanitaire censé contenir l’extrême droite et ses idées. Une porosité qui illustre une banalisation inquiétante de ces idées dans le débat public.
Une alliance objective avec les puissants
Difficile quand on parle des masculinistes et de leur influence de ne pas évoquer… Donald Trump ! Durant sa campagne, le candidat Trump a en effet usé et abusé de la rhétorique masculiniste, s’en servant comme une véritable arme électorale pour recueillir un maximum de voix auprès de certains électeurs masculins. Florence Hainaut n’a pas manqué d’établir un parallèle avec le traitement médiatique de certains procès, notamment celui opposant Johnny Depp à Amber Heard, où l’opinion publique s’est en grande partie alignée sur un récit victimisant pour l’homme, relayé massivement par des groupes masculinistes.
On est également revenu sur la stratégie développée par certains masculinistes pour diviser les forces politiques de gauche. Dans leur théorie, ils tentent d’opposer lutte des classes et luttes féministes, en prétextant que ces dernières affaiblissent la première. On pense notamment à ces vidéos, qui cochent toutes les cases des contenus complotistes, tentant de faire croire que le féminisme a été encouragé,
voire carrément développé, par le patronat pour favoriser l’intégration des femmes sur le marché de l’emploi et faire pression à la baisse sur les salaires. Ou comment plaider insidieusement pour le retour des femmes au foyer au nom du progrès social… Les mascus ne sont pas décidemment à une contradiction près. Mais leur projet reste fondamentalement réactionnaire et au service des puissants.
Agir pour déconstruire, reconstruire pour agir
La rencontre fut également, et surtout, l’occasion d’aborder les stratégies de résistance à développer pour
affronter et déconstruire les théories masculinistes. On a par exemple évoqué la philosophe Judith Butler, pour qui il est indispensable de sortir de la sidération et de réinvestir des projets militants collectifs. En parallèle, il faut continuer à utiliser pleinement les outils juridiques existants, en particulier en organisant une réponse collective face aux attaques masculinistes.
Enfin, on ne fera évidemment pas l’impasse sur l’importance de l’éducation et de la formation. Si l’éducation des enfants est primordiale, celle des adultes l’est tout autant ! Un levier fondamental de transformation qui doit se décliner dans tous les espaces, qu’ils soient scolaires, familiaux, professionnel, associatif ou syndical. Et, dans ces différentes stratégies, les syndicats et l’éducation populaire ont évidemment un rôle clef à jouer.
| Etats généraux féministes : la suite Le prochain rendez-vous est fixé au vendredi 21 novembre, dans les locaux du CEPAG, à l’Espace Solidarité à Beez (Namur). Les États généraux se pencheront sur les violences de genre. |