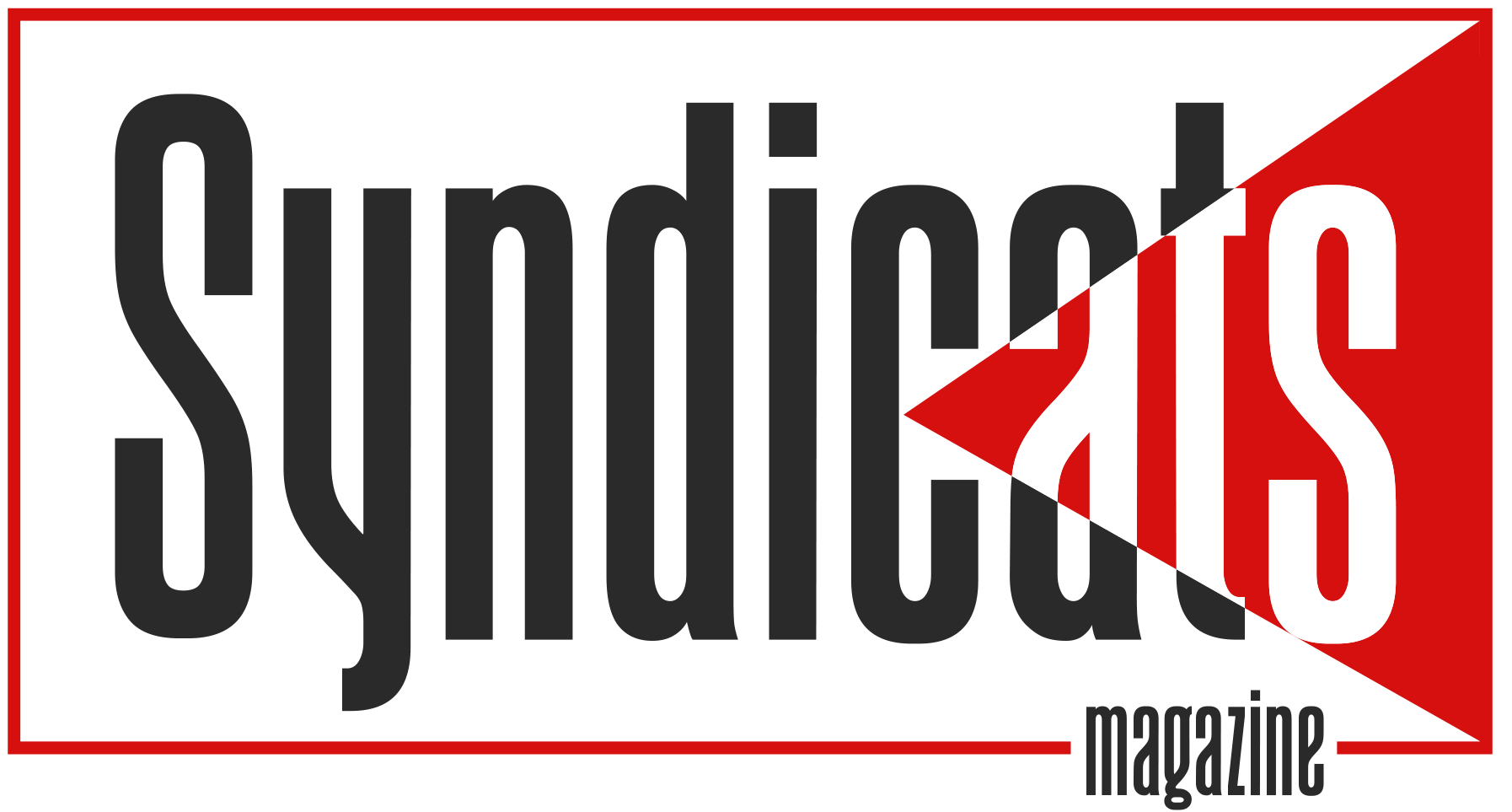La bande dessinée, à l’instar des autres formes d’art, peut se révéler être un outil de communication politique redoutable. C’est même, pour partie, ainsi qu’elle est née : outil de propagande, instrument d’influence culturelle, parfois vecteur d’endoctrinement. Mais rapidement, elle a aussi su devenir un espace de critique sociale, de résistance, voire d’émancipation. De Tintin à Gaston, de Mafalda aux mangas militants, et jusqu’aux actuels « docu-BD », se dessine une histoire parallèle du neuvième art : celle d’un médium populaire qui n’a jamais cessé de dialoguer avec la politique.
Hergé, la BD au service d’une ligne éditoriale conservatrice
On ne peut évoquer l’histoire de la bande dessinée sans citer Hergé. Les premiers albums de Tintin, parus à la fin des années 1920, reflètent fidèlement la ligne éditoriale du Vingtième Siècle, quotidien catholique, conservateur et violemment anticommuniste. Tintin au pays des Soviets est une charge féroce, parfois grotesque, contre le régime bolchévique, caricature à peine voilée des travers prêtés à la révolution russe. Tintin au Congo véhicule pour sa part une vision paternaliste et raciste, typique de la propagande coloniale belge de l’époque.
La trajectoire d’Hergé reste cependant ambivalente. Plusieurs des albums qui suivirent contiennent des critiques déguisées du fascisme ou du colonialisme : Le Lotus bleu dénonce explicitement l’impérialisme japonais en Chine ; Le Sceptre d’Ottokar anticipe l’Anschluss en ridiculisant les manœuvres expansionnistes de la Syldavie. Mais pendant l’Occupation, Hergé continue de publier dans Le Soir « volé », ce qui lui vaudra d’être accusé de compromission avec les nazis.
Son parcours illustre bien une réalité essentielle : dès ses origines, la bande dessinée est un vecteur idéologique puissant. Outil de propagande ou, selon les contextes et les choix d’auteurs, outil de critique et d’émancipation, elle participe pleinement aux batailles culturelles et politiques du XXᵉ siècle.
D’autres classiques belges
Dans les années 60, Gaston Lagaffe, créé par André Franquin, incarne le contre-modèle de l’employé discipliné. Paresseux, rêveur, inventeur raté mais tendre, il ridiculise avec humour les absurdités du monde du travail. Au fil des albums, Gaston devient aussi un pionnier de l’écologie en BD : il s’indigne contre les marées noires, expérimente des véhicules « propres », et refuse la logique productiviste. Franquin, marqué par des engagements humanistes, transforme son personnage en porte-voix d’une génération contestataire. Là où Tintin consolidait l’ordre établi, Gaston l’ébranle doucement, par le rire.
Les premiers albums de Bob et Bobette, publiés à partir de 1945, rencontrent un succès quasi immédiat en Flandre, grâce à leur diffusion dans la presse populaire. Très vite, Willy Vandersteen* glisse dans ses récits des allusions à l’occupation nazie, puis plus tard à la guerre froide et aux dérives technologiques. Citons aussi Urbanus, dans les années 80, qui derrière le grotesque et le scatologique s’en prend régulièrement à l’Église catholique, aux institutions et aux travers de la société bourgeoise.
La BD flamande, trop souvent cantonnée à l’image « classique » de l’école de Vandersteen, participe en réalité elle aussi à cette histoire de résistance . Elle déploie, sous des formes variées, une critique du monde contemporain et une réflexion sur la justice sociale.
À l’étranger
Mafalda, l’héroïne de Quino apparue en 1964, illustre le potentiel subversif de la BD publiée dans un contexte autoritaire. Paradoxalement, ses strips parurent d’abord dans un journal de droite argentin. Mais la petite fille à la chevelure noire et aux questions insupportables devient vite une icône. Elle interroge la guerre du Vietnam, la condition féminine, l’injustice sociale.
Son humour caustique inspira des générations entières, notamment des jeunes filles qui s’identifiaient à sa liberté de ton. Cristina Fernández de Kirchner, future présidente de l’Argentine, a elle-même reconnu l’influence de Mafalda sur sa vocation féministe et politique. Comme quoi, même hébergée dans des journaux conservateurs, la BD peut retourner ses lecteurs contre l’idéologie dominante.
Dans le manga, l’œuvre de Keiji Nakazawa, Gen d’Hiroshima, témoigne de manière poignante des ravages de la bombe atomique. Inspiré par sa propre expérience de survivant, Nakazawa fait de la BD un outil de mémoire et de résistance contre l’oubli, mais aussi contre la militarisation du Japon d’après-guerre.
Aux États-Unis, les comics ont très tôt véhiculé des messages politiques. Captain America, créé en 1941, montre dès la couverture du premier numéro le héros asséner un coup de poing à Hitler, bien avant l’entrée en guerre officielle des États-Unis. Plus tard, dans les années 1970, des séries comme Green Lantern/Green Arrow s’emparent des thèmes de la ségrégation, de la pauvreté et de la contestation du Vietnam.
Ici encore, le médium populaire devient caisse de résonance des résistances politiques et sociales.
Les « docu-BD », nouvelle vague engagée
Depuis une vingtaine d’années, la bande dessinée a pris une tournure documentaire qui renouvelle son rôle politique. Les « docu-BD » combinent enquête journalistique, pédagogie et narration graphique. Ils rencontrent un succès éditorial grandissant : Persepolis de Marjane Satrapi, récit autobiographique sur l’Iran, s’est imposé comme une référence mondiale. Plus récemment, Un monde sans fin, le livre le plus vendu en France en 2022 (plus d’un million d’exemplaires), est une adaptation en bande dessinée des travaux de Jean-Marc Jancovici par Christophe Blain. Il vulgarise la question cruciale de l’énergie et du climat auprès d’un très large public.
Cette hybridation entre journalisme et BD permet de toucher des lectrices et lecteurs qui ne liraient peut-être pas d’essais complexes. La force de l’image, la clarté de la narration et la simplicité du format font de ces albums des outils de mobilisation puissants, parfois plus efficaces que des campagnes de communication classiques.
Quand la BD explore le monde du travail
Au-delà des questions géopolitiques ou environnementales, certains chercheurs en sciences sociales se saisissent aujourd’hui de la BD pour vulgariser leurs travaux sur le monde du travail. L’historien Johann Chapoutot, dans Libre d’obéir, a ainsi adapté en bande dessinée son analyse des origines managériales du nazisme et de la rationalisation du travail. De son côté, la sociologue Isabelle Ferraras a publié Hé patron ! Pour une révolution dans l’entreprise, un essai en BD qui plaide pour la codétermination et une véritable démocratie au travail.
Ces albums traduisent en images et en récits accessibles des concepts parfois jugés austères. Ils montrent que la BD peut devenir une outil pédagogique puissant au service des luttes syndicales et des débats contemporains sur la gouvernance des entreprises, la dignité au travail et la réinvention du salariat.
Quand elle éveille les consciences
De Tintin à Gaston, de Mafalda aux auteurs flamands, de Gen d’Hiroshima aux comics antifascistes, des docu-BD aux vulgarisations sur le monde du travail, la bande dessinée a accompagné – et parfois précédé – les grandes batailles politiques et sociales du XXe et du XXIe siècle.
Qu’elle serve la propagande conservatrice, la critique sociale, la mémoire des tragédies ou la pédagogie syndicale, elle témoigne de sa puissance : celle d’un art populaire qui façonne les imaginaires et peut, parfois, éveiller des consciences militantes.
La BD n’est pas qu’un divertissement : elle est aussi une arme douce, drôle, mais redoutable, dans l’histoire des résistances.
*à noter que, pendant la guerre, Willy Vandersteen a, lui aussi, eu une attitude ambiguë puisqu’il publia des dessins antisémites et des dessins anti nazis. Notre article ne fait référence qu’à l’influence de son œuvre majeure, Bob et Bobette, incontournable en Flandre.

Petite liste arbitraire, militante et incomplète de conseils lectures résistantes :
- – « Un cœur en commun – La belge histoire de la sécurité sociale » par Harald Franssen, qui retrace les origines et le fonctionnement du système belge.
- – « Maus » de Art Spiegelman, auteur américain qui a recueilli les souvenirs d’un survivant de l’Holocauste: son père. Prix Pulitzer 1992.
- – « L’Histoire des 3 Adolf » d’Osamu Tezuka raconte les histoires parallèles d’Adolf – jeune juif allemand, Adolf – fils d’un diplomate nazi et d’une aristocrate japonaise, et Adolf Hitler.
- – « La Jeune fille et le nègre » de Judith Vanistendael aborde le sujet sensible des sans-papiers par le biais d’une chronique familiale.
- – « Palestine » par Joe Sacco, journaliste américain, précurseur de la BD documentaire, signe un reportage graphique sur les réalités vécues en Palestine.
- – « La Présidente » de Durpaire et Boudjellal, imagine les premiers mois qui suivront l’élection de Marine Le Pen à la présidence de la France.
- – « Un homme est mort » de Kris et Davodeau raconte l’histoire vraie d’Edouard Mazé, ouvrier et militant CGT tué lors d’une manifestation en 1950.
- – « Les sentiments du Prince Charles » de Liv Strömquist, autrice suédoise, interroge et critique le fonctionnement sexiste du couple hétérosexuel et de la famille.
- – « Capital & idéologie » de Claire Alet et Benjamin Adam qui proposent une version accessible à tous du best-seller de l’économiste Thomas Piketty.
- – « Mawda » de Manu Scordia, qui nous plonge au coeur d’un fait divers horrible qui a secoué toute la Belgique : la mort d’une jeune migrante de 2 ans, tuée par un policier.