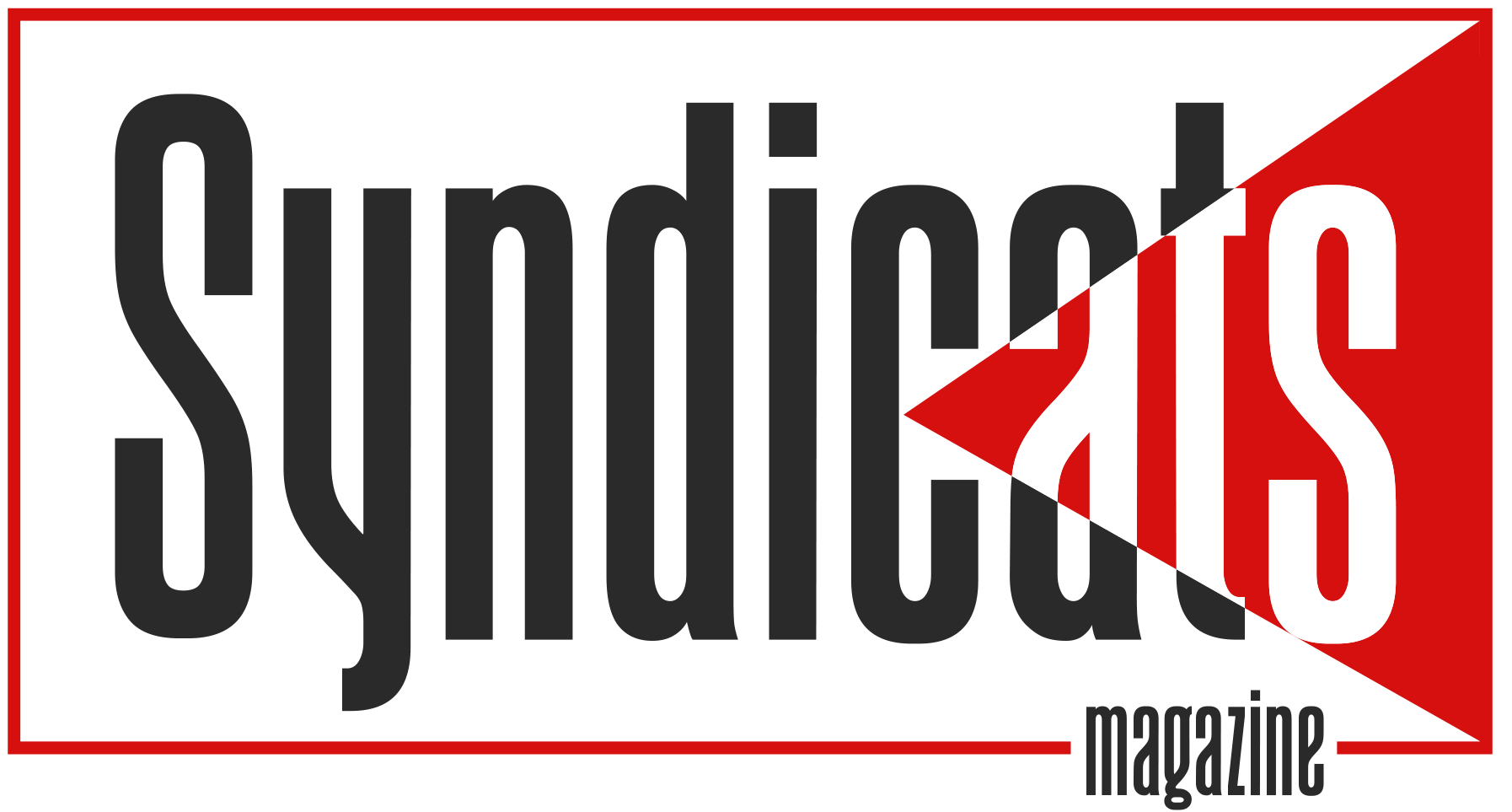À l’Est de la RDC, les droits humains broyés dans une guerre de prédation

Des millions de morts et de déplacés, de la pauvreté, de la famine, le viol utilisé comme arme de guerre… À l’Est de la République Démocratique du Congo, à la frontière du Rwanda, une guerre terrible fait rage depuis plus de 30 ans. « C’est une guerre de prédation pour s’emparer des ressources minières » explique Guy Kuku, Président de la Confédération Démocratique du Travail du Congo (CDT), deuxième syndicat du pays. Ces derniers mois, les violences s‘étaient intensifiées. Récemment, deux accords ont été signés pour mettre fin aux violences. « 30 ans de guerre, cela suffit ! ». Interview.
Cet article contient des descriptions de violences extrêmes, notamment de violences sexuelles et de crimes de guerre, qui peuvent heurter la sensibilité de certain·es lecteur·ices.
Il y a actuellement une guerre dans l’Est du Congo, avec plusieurs groupes armés qui grignotent du territoire et sèment la terreur. Cette région est en guerre depuis plus de 30 ans. Comment l’expliquez-vous ?
Guy Kuku : Il s’agit en réalité d’une guerre économique. Ce sont les multinationales qui instrumentalisent le conflit avec le soutien du Rwanda. Surtout dans des endroits où il y a des mines. On crée de la terreur pour que les gens fuient et qu’on puisse extraire les minerais : du cobalt, de l’or, du coltan,… des minerais utilisés dans les batteries, indispensables pour la transition énergétique. Les multinationales profitent de la guerre. Elles achètent les minerais bon marché. Cela fait 30 ans que cela dure…
Ce sont les multinationales qui instrumentalisent le conflit avec le soutien du Rwanda. On crée de la terreur pour que les gens fuient et qu’on puisse extraire les minerais.
Guy Kuku, Président de la Confédération Démocratique du Travail du Congo (CDT)
Comment tout cela a-t-il commencé ?
Tout a commencé en 1994, après le génocide au Rwanda. La République démocratique du Congo a accueilli les réfugiés rwandais pour les protéger. Mais par la suite, le Rwanda a retourné la situation et a prétendu intervenir au Congo pour protéger les Rwandophones. Aujourd’hui, grâce à l’appui de la MONUSCO (Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en république démocratique du Congo), nous avons pu démontrer qu’il s’agit d’une guerre de prédation, pour prendre le contrôle des ressources minières. La preuve ? Le Rwanda ne possède pas de ressources minières sur son sol… et il est pourtant devenu l’un des plus gros exportateurs mondiaux.
Quelle est la situation humanitaire actuelle à la frontière avec le Rwanda ?
Elle est catastrophique : viols, assassinats, tueries, déplacements massifs, destruction d’hôpitaux, de villages, de cultures… Les rebelles ont pris le contrôle de l’agriculture et du secteur informel. Les populations ne peuvent plus cultiver. La famine envahit la province.
Face à l’insécurité, les populations fuient massivement. Elles sont à la recherche constante d’abris. On compte aujourd’hui plus de 7 millions de déplacés internes sans assistance, parce que le pays n’a pas les infrastructures pour accueillir les réfugiés. Les gens se réfugient dans des forêts… Beaucoup se sont installées à Kinshasa, devenue une ville surpeuplée, infernale.
Encore une fois, les femmes sont parmi les plus grandes victimes. Elles sont utilisées comme arme de guerre…
C’est l’un des aspects les plus terribles du conflit. Les violences sexuelles sont systématiques, utilisées pour terroriser et humilier. Dans notre société, une femme violée est stigmatisée. Elle ne peut pas parler de ce qu’elle a subi, au risque d’être rejetée par sa famille. Aucun homme n’accepte d’épouser une femme victime de viol.
Les violences sexuelles sont systématiques, utilisées pour terroriser et humilier.

Et ce sont parfois des actes inimaginables. Des enfants violés ou forcés à violer leur propre mère. Des femmes violées devant leur mari, puis l’homme est exécuté, et la femme reste, seule, avec un traumatisme indélébile. Que va-t-il advenir de ces femmes après le conflit ? Il faudra des années de soutien psychologique…
À tout cela s’ajoutent la pauvreté et l’insécurité. Des veuves, des orphelins livrés à eux-mêmes, sans emploi, sans revenus. Cela pousse certaines femmes à se prostituer pour survivre.
Qu’en est-il des travailleurs et travailleuses ? Comment cette situation les impacte-t-ils/elles ?
Il n’y a plus de circulation de liquidités. En temps normal, c’est l’État qui verse les salaires des travailleurs. Mais depuis plus de cinq mois, le gouvernement n’envoie rien. Les travailleurs ne sont pas payés parce qu’il n’y a plus de recettes.
La majorité des habitants ont fui les zones de conflit. Ils ont perdu leur emploi, leurs revenus… Certains se sont réfugiés dans d’autres régions du pays, d’autres ont traversé les frontières vers les pays voisins.
À Goma, des entreprises entières ont été pillées. Des machines, des coffres-forts, tout a été emporté. Il ne reste plus rien. À ce jour, on recherche les responsables…
Quel est le rôle des organisations syndicales dans un contexte de guerre comme celui-ci ?
Sur le terrain, la marge de manœuvre des syndicats est extrêmement réduite. On est dans un contexte de terreur. Ce sont les groupes armés qui font la loi. Le siège de la CDT à Goma a été pillé. Les syndicalistes ne peuvent plus se réunir, ils entrent dans la clandestinité.
Mais le combat syndical ne s’arrête pas pour autant. À l’échelle internationale, notre rôle est de sensibiliser afin que cette guerre cesse. L’Union européenne signe des accords commerciaux sur les minerais avec le Rwanda, alors que ce pays ne possède pas ces ressources. Signer ce genre d’accords, c’est une façon d’encourager le Rwanda à aller tuer pour s’emparer des minerais et ensuite les vendre. Ils tuent, ils violent, et l’UE signe des accords avec eux ? Ce sont des minerais de sang…

« L’Union européenne signe des accords commerciaux sur les minerais avec le Rwanda. Signer ce genre d’accords, c’est une façon d’encourager le Rwanda à aller tuer pour s’emparer des minerais et ensuite les vendre. »
— Guy Kuku, Président de la Confédération Démocratique du Travail du Congo (CDT)
On parle de solidarité avec l’Ukraine, Gaza, mais où est la solidarité avec le Congo ? Il y a eu plus de 6 millions de morts en 30 ans. Combien de temps faudra-t-il pour réagir ?
Il y a aussi la responsabilité des entreprises qui achètent le minerais du Rwanda. Certaines se sont même installées au Rwanda. Ces entreprises financent la guerre. On demande à l’UE de retracer toutes les chaines d’approvisionnement pour s’assurer que les minerais soient achetés dans de bonnes conditions.
La conquête des minerais est l’une des conséquences du capitalisme…
En effet. Aujourd’hui il, y a une guerre économique entre les USA, la Chine et l’UE. Tous les minerais rares se trouvent en Afrique, au Congo. La capitale mondiale du cobalt c’est le Kolwezi. Le capitalisme suit une logique implacable : repérer les ressources et chercher à se les approprier, à tout prix. Pour cela, il n’hésite pas à alimenter des conflits, attiser les tensions.
Un accord de paix a été signé entre le Rwanda et la RDC le 27 juin. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Tout d’abord, cet accord change le narratif dominant. Il met le Rwanda face à ses responsabilités. Les deux pays sont appelés à coopérer pour résoudre les problèmes qui les opposent. Mais nous craignons que le Rwanda refuse de collaborer, car il tire un profit financier énorme de cette situation.
Il y a toutefois un élément qui nous permet d’être optimistes : la médiation des États-Unis. Une commission réunissant les deux pays doit désormais s’atteler – sous l’égide des États-Unis – à résoudre les causes du conflit. Il faut rappeler que les États-Unis ont été le principal soutien du Rwanda dans cette guerre. Si aujourd’hui même eux semblent déterminés à y mettre fin, on peut espérer un changement, car les États-Unis ont le poids politique et les moyens pour faire pression sur le Rwanda. Mais cet optimisme reste mesuré. Il subsiste une inquiétude, car l’Union européenne – et en particulier la France – continue de soutenir le Rwanda dans cette mésaventure.
La véritable garantie aujourd’hui, c’est la détermination du peuple congolais. Dans toutes les provinces du pays les citoyens s’engagent pour la défense des territoires occupés. Le Rwanda, aujourd’hui plus qu’hier, ne pourra pas s’en sortir impunément.
Quelle attitude espérez-vous de la Belgique ?
Sans une pression internationale forte et coordonnée, il n’y aura pas de solution durable pour l’Est de la République démocratique du Congo. La Belgique – partenaire historique du pays – joue un rôle essentiel. Toutes les institutions sont sur son territoire. Elle peut influencer à la fois l’Union Européenne et d’autres pays comme les États-Unis, parce qu’elle discute aussi avec eux. Encore faut-il qu’elle porte ce plaidoyer sur la scène internationale. Trente ans de guerre, cela suffit.
A-t-elle un rôle important à jouer notamment à cause de son passé colonial ?
Absolument. Dans tous les cas, lorsqu’il s’agit de la RDC, la Belgique est au courant, si pas associée, dans tout ce qui se passe. Elle a une responsabilité. L’accord de minerais entre l’UE et le Rwanda a été signé sous la présidence belge du Conseil de l’UE…
En Belgique, les budgets dédiés à la solidarité internationale seront revus à la baisse à cause du nouveau gouvernement. Et c’est le cas aussi dans de nombreux autres pays, comme les États-Unis. Quelles seront les conséquences sur le terrain ?
Les annonces de réduction des budgets alloués à la coopération internationale inquiètent fortement. Sur le terrain, ces coupes budgétaires auront des conséquences directes. Ce sont les programmes portés par les organisations militantes, les défenseurs des droits humains et la société civile qui seront touchés.
Ces structures jouent pourtant un rôle fondamental : elles documentent les violations, informent les populations, forment les jeunes, équipent les hôpitaux, contribuent au développement communautaire. Ces aides sont indispensables, d’autant plus dans ce contexte de guerre et d’extrême pauvreté. Au moment où on en a le plus besoin, on décide de les arrêter…
Si vous deviez envoyer un message aux décideurs du monde entier, quel serait-il ?
Construisons la paix, partout dans le monde. Arrêtons les injustices, l’hypocrisie internationale et les mesures ou solutions à géométrie variable. Ce qui est considéré comme un crime en Occident devient un simple « conflit périphérique » lorsqu’il se déroule en Afrique. On détourne le regard.
Construisons la paix, partout dans le monde. Arrêtons les injustices, l’hypocrisie internationale et les mesures ou solutions à géométrie variable.
guy kuku, Président de la CDT
Pour la République Démocratique du Congo, nous exigeons la justice. Il faut que les tribunaux internationaux jugent les responsables de trente années de crimes de guerre. Il a fallu plus de soixante ans pour revenir sur l’assassinat de Patrice Lumumba. Mieux vaut tard que jamais, certes. Mais il ne faut pas attendre autant pour appliquer la justice internationale. C’est une demande de la société civile congolaise : justice pour la RDC. Plus personne ne doit être au-dessus des lois. Quiconque commet un crime contre l’humanité doit en répondre.
Depuis la réalisation de l’interview, un accord de cessez-le-feu entre le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, et le gouvernement de la RDC a été signé. Plus d’infos ici.
© Photos : Johanna de Tessières – Solsoc.