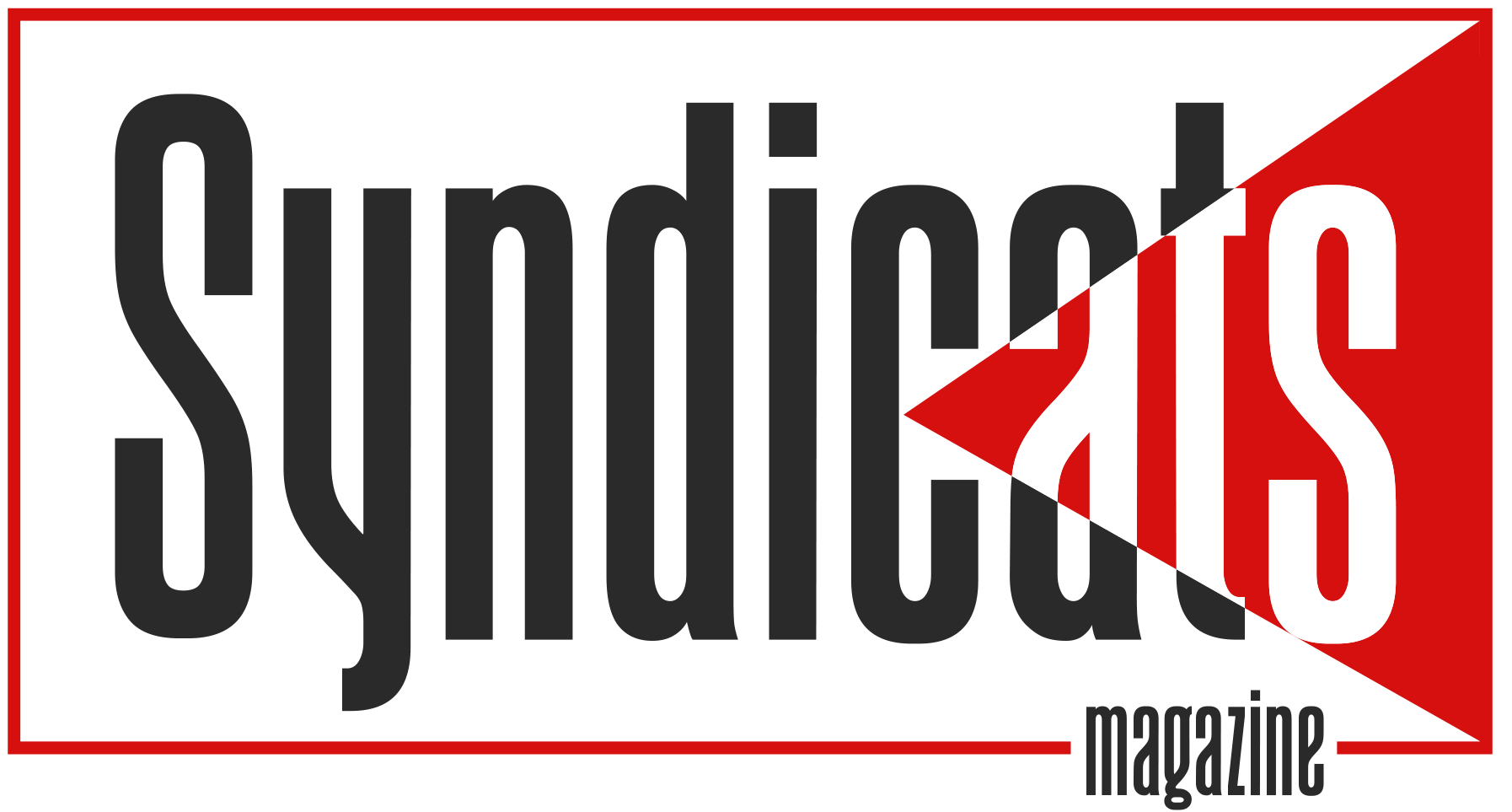En Colombie, ouvriers du secteur alimentaire et paysans, main dans la main

Palmira, à quelques dizaines de kilomètres de Cali, au sud-ouest de la Colombie. Une région dominée par la monoculture de la canne à sucre. Et les conditions de travail déplorables du secteur : horaires exténuants, problèmes de santé récurrents, absence de protection sociale. Le dialogue social y est difficile, voire inexistant. Mais face à ces obstacles, avec le soutien de la FGTB Horval et de l’ONG Solsoc, les travailleurs résistent. Ils s’organisent, arrachent des victoires, et développent leurs propres projets porteurs d’espoir. Reportage.
Le paysage de Palmira, dans la Vallée du Cauca, est atypique. Là où auparavant s’étendait une grande réserve agricole avec de nombreuses cultures différentes, il ne reste plus que des cannes à sucre. À perte de vue. À l’horizon, d’immenses usines. Et une fumée grise qui envahit le ciel. De temps en temps, dans la chaleur, sous le soleil, des travailleurs en uniforme avec leurs machettes.
Conditions de travail proches de l’esclavage
Olaver Balanta Quintana est coupeur de canne pour l’entreprise Manuelita. « Les conditions de travail sont particulièrement difficiles », explique-t-il. Il n’y a pas de salaire horaire : la rémunération dépend uniquement de la quantité de canne coupée chaque jour. Très peu de pauses durant les heures de travail. Les travailleurs ont droit à seulement 15 jours de congé par an, le strict minimum. Ils travaillent souvent pour des sous-traitants, ce qui déresponsabilise les entreprises en cas d’accident ou autre souci.


Et ce, alors que les conditions de santé et de sécurité au travail sont particulièrement dangereuses. Olaver confie, un grain d’émotion dans la voix : « J’ai des problèmes de colonne vertébrale. J’ai souffert de hernies discales à cause des mouvements répétitifs que j’effectuais. J’ai dû être opéré, et on m’a implanté deux barres en métal dans la colonne. Je ne me sens plus comme avant… ». Aujourd’hui, Olaver ne coupe plus les cannes. Il a été affecté à un autre poste qui consiste à nettoyer les mauvaises herbes autour de la canne, avec un salaire inférieur. « Je n’ai pas eu le choix », regrette-t-il. Il n’est malheureusement pas le seul dans ce cas…
En décembre dernier, 59 des 65 coupeurs de canne de Manuelita étaient blessés. Dans certaines entreprises, comme chez Pichici où travaillent la majorité des affiliés de Sintracatorce – syndicat historique de l’industrie sucrière – lorsqu’un travailleur est en arrêt maladie, il ne perçoit que 50% de son salaire. « Pourtant, les bénéfices de l’entreprise sont très élevés », explique Fernando Lasso, président de Sintracatorce.
Pollution et changement climatique
Mais les problèmes de santé des travailleurs ne sont pas seulement liés aux postures et aux mouvements répétitifs. Des études révèlent une augmentation des maladies respiratoires causées par la pollution de l’air, ainsi que des pathologies associées à l’exposition aux pesticides. Olaver confirme : « De nombreux travailleurs souffrent de problèmes pulmonaires à cause des produits chimiques très puissants répandus sur la canne. »
« L’industrie sucrière contribue fortement à la pollution de l’air, de l’eau et des sols. » ajoute Fernando. « Le glyphosate utilisé dans les monocultures de canne à sucre s’infiltre dans les nappes phréatiques, affectant les ressources en eau. » D’autres industries, comme Nestlé, déversent des eaux usées insuffisamment traitées dans les rivières, nous explique Edwin Mejia Correa, président de Sinaltrainal – syndicat du secteur alimentaire présent chez Nestlé. De nombreux cours d’eau ont vu leur débit se réduire – voire disparaître – en partie à cause de la déforestation et du pompage des eaux profondes pour l’agriculture intensive.

Et qui dit pollution intensive et altération des écosystèmes dit changement climatique. Edwin a constaté une augmentation significative des températures ces 20 dernières années. « Les saisons sont devenues imprévisibles et les pluies irrégulières, avec des tempêtes intenses suivies de longues périodes de sécheresse ».
Conséquences sociales
Les conséquences sociales sont multiples. D’une part, on observe les impacts sur la santé des travailleurs de l’industrie, déjà évoqués. Mais d’autre part, on déplore aussi les déplacements forcés de communautés rurales, expulsées pour laisser la place à des entreprises du secteur agroalimentaire ou à des projets d’infrastructures, comme des barrages hydroélectriques. Par ailleurs, le modèle agricole promu par les multinationales, fondé sur la monoculture, a entraîné une baisse de la production locale de denrées alimentaires, accentuant la dépendance aux importations et faisant grimper les prix.
Le pouvoir écrasant des multinationales
Dans la région, le pouvoir des multinationales est écrasant. « Le secteur sucrier est extrêmement influent. Les entreprises contrôlent la santé, la politique, les universités, voire le système judiciaire… Il est très difficile de les poursuivre en justice », explique Fernando. Et ce, alors que la corruption sévit, et qu’elle empêche l’application de certaines lois, notamment environnementales.
Autre réalité inquiétante : le secteur de la santé est étroitement lié aux entreprises. Dans la région, se faire soigner relève d’un véritable parcours du combattant. C’est le cas de Yovany Durango Arevalo, coupeur de canne pendant 20 ans, aujourd’hui paralysé à la suite d’un accident de travail. Ballotté d’un médecin à l’autre, il se bat depuis dix ans pour obtenir des soins et faire valoir ses droits…
Dialogue social compliqué
Lorsque les travailleurs s’organisent, ils font face à des intimidations, des menaces et, parfois même, des assassinats. « Personnellement, ils m’empêchent désormais de participer aux négociations. Ils prétendent que je ne fais pas partie de l’entreprise sous prétexte que je travaille pour un sous-traitant », explique Fernando. «Il y a énormément à faire pour améliorer les conditions dans l’entreprise. Mais ce qu’ils veulent avant tout, c’est faire disparaître le syndicat Sintracatorce, parce que nous portons des revendications justes pour les travailleurs », s’indigne Olaver. « C’est notamment grâce au soutien de la FGTB Horval et de l’ONG Solsoc que nous sommes toujours là ». La pression exercée est si forte que certains syndicalistes finissent par quitter l’organisation…

« Ce qu’ils veulent avant tout, c’est faire disparaître le syndicat Sintracatorce, parce que nous portons des revendications justes pour les travailleurs ».
— Olaver Balanta, Coupeur de canne et syndicaliste
Malgré le dialogue social compliqué, plusieurs victoires ont été arrachées : la régulation des horaires, de meilleurs salaires, la sécurité sociale pour les travailleurs en incapacité, du matériel médical en cas d’accident dans les champs… Et ce, notamment grâce à une grève historique de 56 jours menée en 2008 qui a fait plier les employeurs. Preuve que la lutte paie. En 2017, ils obtiennent également la diminution de jours de travail de 6 jours par semaine à 5.

Des projets porteurs d’espoir
Pour résister à cette industrie agroalimentaire irrespectueuse tant des droits des travailleurs que de l’environnement, plusieurs syndicats du secteur se sont alliés à des organisations d’agriculteurs locaux. Ensemble, ils explorent des alternatives et des moyens de favoriser une véritable transition des systèmes alimentaires. Parmi ces initiatives, l’on retrouve la Casa Cactus et son marché hebdomadaire, mais aussi l’école syndicale agroécologique (ECAS), toutes deux appuyées par les organisations belges mentionnées ci-dessus.
La maison culturelle syndicale
La Casa Cactus est bien plus qu’un simple bâtiment. C’est une maison culturelle syndicale inaugurée le 14 juin 2023, date symbolique marquant la grève historique des coupeurs de canne en 2008. Son ambition : offrir un espace de réflexion, de formation et d’émancipation aux travailleuses et travailleurs du secteur alimentaire. Depuis son ouverture, plusieurs ateliers y ont été organisés en collaboration avec l’université, autour de thématiques essentielles : les droits des travailleurs, l’histoire du mouvement ouvrier, la justice alimentaire, les enjeux écologiques… « Pour nous, cet espace est une véritable bénédiction », explique fièrement Olaver. C’est aussi là qu’ont lieu les négociations avec les entreprises. Les mener dans un tel cadre confère de la légitimité aux syndicats.
Mais la Casa Cactus, c’est aussi du concret, au quotidien. Au rez-de-chaussée, un cabinet médical permet de prodiguer des soins infirmiers aux travailleurs et à leurs proches. Il y a tout un programme de santé communautaire qui y est développé et qui vise la protection sociale des travailleurs.
Et ce n’est pas tout : un partenariat a été noué avec des agriculteurs de la région qui, toutes les deux semaines, tiennent un « marché ouvrier paysan » devant la maison. Ils y proposent des produits locaux, de qualité, à des prix justes. « C’est une manière plus intéressante de produire de la nourriture. En utilisant des graines propres, sans pesticides. Les entreprises ne sont évidemment pas intéressées par ce genre de production. Elles, ce qu’elles recherchent, c’est le profit à tout prix. Alors que diversifier la culture et produire des aliments de qualité pourrait générer des emplois… », explique Fernando.
L’école syndicale agroécologique (ECAS)
Un nouveau projet a récemment vu le jour dans les montagnes qui entourent Palmira : l’École syndicale agroécologique (ECAS). Cet espace de formation est dédié aux questions agroécologiques et s’adresse aux travailleurs et travailleuses du secteur alimentaire ainsi qu’à leurs familles. Ils peuvent s’y retrouver les week-ends, cultiver le potager collectif, reforester les zones dégradées, apprendre, échanger, se ressourcer.



| Colombie, terre agricole Pour comprendre l’importance du mouvement paysan colombien, il faut se pencher sur la nature et l’histoire du pays. Sucre, cacao, bananes, avocats, café… la Colombie est une terre riche en ressources naturelles. L’agriculture paysanne produit 70% de la nourriture consommée. Mais c’est précisément cette richesse qui a causé tant de torts à ses habitants. Lorsque les grands latifundistes, les trafiquants de drogue, les groupes paramilitaires et les grandes entreprises ont pris conscience de son potentiel, ils se sont appropriés les terres. Durant le conflit armé qui a duré 50 ans, plus de 6 millions de paysans ont dû quitter leurs fermes, leur principal moyen de subsistance. Aujourd’hui, 0.8% des propriétaires détiennent 44 % des terres cultivables du pays. À cause de cette répartition inégale des terres, plus de la moitié des familles rurales vivent dans la pauvreté. Pourtant, ce sont bien elles qui créent les richesses du pays… Capitalisme, quand tu nous tiens… |
Un changement de modèle
Tous les syndicalistes rencontrés s’accordent sur une chose : la nécessité d’une transformation profonde du système économique actuel. Pour Juliana Millan, directrice d’ATI – ONG de défense des droits humains – et coordinatrice des projets, nous devons passer à un modèle plus juste, « qui ne concentre pas la richesse dans les mains de quelques entreprises tout en exploitant les travailleurs et l’environnement ».
Le mouvement syndical joue un rôle primordial dans cette transition. « Les ouvriers connaissent les processus de production et peuvent proposer des alternatives.
Une transition vers un modèle plus respectueux de leurs droits et de l’environnement ne peut pas se faire sans les ouvriers du secteurs alimentaire.
Edwin Mejia Correa, président du syndicat Sinaltrainal
Ne pas subir, mais résister… en proposant des alternatives ! C’est la philosophie des camarades colombiens croisés sur notre chemin. Comment? En valorisant ceux et celles qui connaissent le mieux la terre et ses aliments : ceux qui les produisent et ceux qui les transforment, les paysans et les ouvriers. En respectant la terre. En offrant une alimentation saine et équilibrée et des conditions de travail décentes à toutes et tous, de la fourche… à la fourchette !

| Ce reportage a été réalisé dans le cadre de la campagne « JUST » sur la transition juste, menée par l’IFSI, Solsoc et FOS. Plus d’infos sur la campagne ici. |